JOURNAUX DE MARCHES - HISTORIQUES
|
|
Historique du
|
La devise du bataillon est "Droit devant Loin devant"
Cette unité, équipée de 45 chars R 35, aux ordres du commandant Aussenac est rattachée administrativement au 504e Groupe de Bataillons de Chars de Combat (GBCC) et affectée à la IVe Armée.
27 août 1939
Le 27 août 1939, premier jour de mise en application des mesures de couverture générale et couverture du Sud-Est, le 10e bataillon est mis sur pied :
| Chef de bataillon : commandant AUSSENAR E.M. : capitaine chef de l’Etat-Major : capitaine GAUTHIER Officier de renseignement : lieutenant PATURLE Officier des détails : lieutenant GUIMINEL Officier adjoint technique : sous-lieutenant PELLISTRANDI |
Compagnie d'Echelon : Capitaine commandant la Compagnie : capitaine PERRIN Lieutenant au service de dépannage : lieutenant PESOEL Lieutenant au service de l’atelier : lieutenant BUGAUD Lieutenant au service du ravitaillement : sous-lieutenant TOUBE Section de transport : chef de section lieutenant HYVERT |
| 1ère compagnie Lieutenant TANCREDI Chef de sections : Lieutenant GREGOIRE Sous-lieutenant GIAUME Sous-lieutenant MAGNAN Sous-lieutenant ATTANE Chef de la S.E. lieutenant POIGNY |
2e compagnie Capitaine LEFORT Chef de sections : Sous-lieutenant HYZARD Sous-lieutenant PERFFER Sous-lieutenant DAMOTTE Sous-lieutenant ROUSSEAU Lieutenant GUILLET |
3e compagnie Capitaine Boreau de Roincé |
Il est stationné à Sarre-Union dans la zone du secteur fortifié de Faulquemont et reste en attente dans cette garnison jusqu’à la création de la 3e Division Cuirassée.
Enlèvement par voie ferrée de la 3e compagnie (échelon A) du 10e bataillon en gare de Valence à 11h41.
Exécution pour les unités du groupe des mesures prévues au deuxième jour des horaires de mobilisation.
29 août 1939
L’incorporation des réservistes se poursuit normalement dans les cantonnements de mobilisation, ceux-ci ont presque tous rejoint.
30 août 1939
Continuation des opérations d’organisation des unités mises sur pied. Parachèvement de l’habillement des réservistes.
La perception des voitures de réquisition s’est accélérée dans la journée. Il reste à percevoir des véhicules spéciaux, camions de 10 et 15 tonnes, des tracteurs, des motos. Certains de ces véhicules ne répondent pas aux conditions de leur destination, ils devraient faire l’objet d’un échange avec des véhicules plus appropriés.
31 août 1939
Suite des opérations de mobilisation. Complètement des unités en hommes et en matériel. Les hommes touchent leurs effets militaires et l’armement.
Le colonel du CHAUCHEZ passe en revue le Bataillon sur un terrain près de Riviers et inspecte le cantonnement à Thodure.
1er septembre 1939
Suite des opérations de mobilisation pour le bataillon.
2 septembre 1939
Premier jour de la mobilisation générale, les réservistes convoqués arrivent et rejoignent leur cantonnement.
3 septembre 1939
Embarquement et enlèvement par voie ferrée en gare de Valence :
- d’un premier train transportant la 1ère compagnie, l’E.M. du groupe, le complément de la 3e compagnie partie ensemble échelon A.
- d’un deuxième train avec la 2e compagnie.
4 septembre 1939
Embarquement et enlèvement par voie ferrée de la compagnie d’échelon.
La section de transport rejoint par voie de terre.
6 septembre 1939
Arrivée à Petit-Tenquin de la section de transport qui a rejoint par la route après une halte à Mâcon.
8 septembre 1939
Le 10e bataillon est mis à la disposition de la 4e DINA,
Le PC du bataillon se trouve à Guebenhouse.
Les unités du bataillon devant être engagés reconnaissent et rejoignent en fin de journée leur position de départ pour l’attaque du lendemain.
9 septembre 1939
Partant de la frontière, le XXe C.A. agissant en direction de Saralle-Saint-Ingbert a pour mission d’attaquer en force par son centre le rentrant d’Auersmacher entre Sarre et Blies en vue de s’emparer des observatoires importants, de ce mouvement de terrain, de préciser le contact et de s’assurer une meilleure base de départ pour les opérations ultérieures.
Il n’y a pas eu de chars allemands sur le terrain le 9 septembre mais des chars français pris pour des chars ennemis ont été tirés par des canons de 25 français sans grand dégâts.
10 septembre 1939
Le 10e bataillon n’est pas engagé.
P.C. du bataillon à Gebenhouse.
11 septembre 1939
Le 10e bataillon occupe toujours les mêmes points.
12 septembre 1939
La 2e compagnie rejoint en fin de journée le bois Bliesbruck en réserve de C.A.
13 septembre 1939
Le XXe C.A. reçoit comme mission de se maintenir solidement sur les hauteurs Spicheren – bois de Saint-Arnual, et de continuer à progresser à l’Est de la Sarre, en direction générale Frauenberg – Ormesheim – Rohrbach, en vue de s’assurer la possession des observatoires de la crête sud de la coupure Fechingen – Ormesheim et la région du Holschberg.
La position à occuper en fin d’opération qui lui est fixé englobe :
- Stiring-Wendel
- les hauteurs de Spicheren
- la crête du bois de Saint-Arnual
- la croupe 298 (N-O de Hanbush)
- le Birnberg
- le Hinterwald
- l’Uberwald
- le Koppelberg
- le Kirchenwald.
La 2e Cie du bataillon fait un mouvement et s’installe à Reinheim.
Les chars disponibles en fin de journée sont :
- 1ère Cie : 15 chars ;
- 2e Cie : 13 chars ;
- 3e Cie : 14 chars ;
14 septembre 1939
Pas de changement pour les points de stationnement du bataillon.
L’état des chars disponibles est de 44.
15 septembre 1939
Pas de mouvements ni opérations effectuées.
16 septembre 1939
Remaniement dans le dispositif des chars : le bataillon F.C.M. n°4 au groupe 510 en réserve d’armée à Loudrefing, remplace le 10e bataillon à la disposition de la 4e D.I.N.A. sous réserve qu’il ne sera pas employé sans autorisation de l’armée.
Le 10e bataillon passe en entier à la disposition de la 21e D.I.
17 septembre 1939
Le bataillon de chars F.C.M. n°4 et le 10e bataillon ont rejoint le premier la région de Metzing-Gebenhouse, le deuxième la région où se trouvait précédemment le 20e bataillon.
Le P.C. à Blies-Ebersing.
18 au 21 septembre 1939
Sans mouvements ni opérations.
22 septembre 1939
Le 10e bataillon passant en réserve de C.A. effectue son mouvement sur Sarreguemines sauf la C.E. qui exécutera le sien dans la nuit du 23 au 24 septembre.
23 septembre 1939
Le bataillon occupe les emplacements suivants :
- P.C. du bataillon : asile d’aliénés de Sarreguemines
- C.E. : Wiesviller
- Une compagnie Est de Mulhenwald à la 11e D.I.
- Une compagnie à l’Est de Behlsheim à la disposition de la 21e D.I.
- Une compagnie à Sarreguemines.
24 septembre 1939
La Cie d’échelon du bataillon rejoint Sarreguemines.
25 septembre 1939
Le capitaine TOLOZAN de la 3e compagnie est évacué pour maladie.
Le lieutenant BASTIEN prend le commandement de cette compagnie.
26 septembre 1939
Le bataillon 35 R n°10 est affecté au XXe C.A. sous les ordres du lieutenant-colonel
du CHOUCHET, commandant le groupe de bataillons n°504.
Deux tracteurs de la C.E. du 10e bataillon ont assuré la mise en place de deux carcasses FT dans le secteur de la 11e D.I.
27 septembre 1939
R.A.S.
28 septembre 1939
La S.T. du 10e bataillon transporte 6 chars FT du 510e de Rohrbach à Puttelange.
29 septembre 1939 au 2 octobre 1939
R.A.S.
3 octobre 1939
Le 10e bataillon à l’exception de la 1ère et 2e compagnies reçoit l’ordre de se replier sur Altwiller.
Le 10e bataillon (moins 2 compagnies) est en réserve de C.A.
4 au 9 octobre 1939
R.A.S.
10 octobre 1939
La S.T. du bataillon a transporté une compagnie de chars FT (Cie AUGOL) à Saint-Avold.
La 1ère Cie du bataillon s’est rendue du bois de Velferding à Roth.
11 – 12 octobre 1939
R.A.S.
13 octobre 1939
La S.T. du bataillon a transporté une Cie du 11e bataillon (capitaine LAURENT) de Rechicourt dans la région de Saint-Avold.
Dans la soirée, la 3e compagnie (lieutenant BASTIEN) s’est portée à Rémelfing (sortie Sud).
L’E.M. du 10e B.C.C. s’est portée à Neufgrange (sortie Ouest).
14 – 15 octobre 1939
R.A. S.
16 octobre 1939
La compagnie FT qui se trouvait à Richecourt est transportée à Etting par la S.T. du 10e B.C.C.
Dans l’après-midi : attaque par surprise sur le front du XXe C.A.
Le combat dure toute la soirée et la nuit.
Les chars ne sont pas engagés.
17 octobre 1939
La 3e compagnie et l’Etat-major du bataillon retournent à Altwiller et occupent le cantonnement où elles se trouvaient précédemment.
La S.T. se cantonne à Loudrefing.
Les Allemands ayant déclenché une attaque en direction de Sarreguemines, une section de la 1ère compagnie commandée par le lieutenant GREGOIRE est envoyée à Sarreguemines où elle protège l’enlèvement du pont de génie construit sur la Blies le 9 septembre.
18 - 19 octobre 1939
R.A.S.
20 octobre 1939
La S.T. transporte de Lunéville à la ferme de Strohhof sept chars FT destinés à la traction de charrues Bajac.
Le capitaine GAUTHIER chef d’E.M. du bataillon rentre à Valence.
La 2e Cie se trouve toujours dans la région de Zetting. La 1ère compagnie stationnée Roth a été alertée à 3h du matin s’est portée par ordre de l’ID/11 à Sarreinsming en vue d’une contre-attaque éventuelle à effectuer en direction du bois de Bliesguersviller.
Elle est de retour à Roth dans le courant de l’après-midi.
21 octobre 1939
R.A.S.
22 octobre 1939
A 11h du matin, venant du dépôt arrive un renfort de remplacement comprenant :
- 1 sous-lieutenant : BOULON;
- 1 aspirant : MATHIEU
- 4 sergents, 2 caporaux et 17 chasseurs.
Les chars d’instruction de la compagnie du capitaine BOURQUET et du capitaine
de la RUPELLE sont employés à tracter des charrues Bajac pour le creusement des tranchées, ces travaux jusqu’à présent ne donnent rien de positif.
23 octobre 1939
Continuation des essais de traction des charrues Bajac dont les résultats s’avèrent médiocres.
24 octobre 1939
Départ à Valence d’un détachement comprenant :
- 1 officier : sous-lieutenant MAGNAN;
- 1 adjudant, 3 sergents et 3 caporaux
Les compagnies du 10e et du 11e BCC procèdent à des reconnaissances et travaillent à l’entretien de leur matériel.
25 - 26 octobre 1939
R.A.S
27 octobre 1939
Reconnaissances, régions Altwiller – Lunéville.
28 octobre 1939
Reconnaissances dans la région de Cappel et Saint-Jean-Rorhbach.
29 octobre 1939
Reconnaissances dans la région de Nousseviller, Diebling.
30 octobre 1939 au 2 novembre 1939
R.A.S. Les compagnies entretiennent le matériel.
3 novembre 1939
Le bataillon effectue des reconnaissances et entretien son matériel.
4 novembre 1939
Les compagnies continuent leurs reconnaissances et l’entretien de leur matériel.
7 novembre 1939
Le chef de bataillon effectue une reconnaissance générale dans la région de Saint-Jean de Rohrbach.
La 3e Cie reconnaît l’axe Gréning, Nelling, Zellen.
9 - 11novembre 1939
Reconnaissance et entretien du matériel pour les Compagnies.
12 novembre 1939
Essais à Altwiller en présence du lieutenant-colonel du CHOUCHET, des insignes et marques distinctives sur des chars de la 3e Cie du 10e bataillon.
14 novembre 1939
Le sous-lieutenant PELLISTRANDI affecté spécial est dirigé sur Valence, cet officier adjoint technique à l’E.M. est remplacé par le lieutenant BARTE-DEJEAN.
La première compagnie effectue des reconnaissances sur la ligne L 1.
15 novembre 1939
Reconnaissances et travaux d’entretien pour les compagnies.
16 novembre 1939
La 1ère compagnie cantonne à la ferme de Schueckenbrulh et procède à son installation.
17 novembre 1939
Entretien du matériel et reconnaissances diverses pour les compagnies.
18 novembre 1939
Les Cies étudient leur secteur en vue de l’emploi des chars.
19 novembre 1939
Rien de particulier en dehors des reconnaissances et de l’entretien du matériel pour les compagnies.
20 novembre 1939
Le commandant AUSSENAC rend visite à la 1ère et 2e compagnie.
La 2e Cie effectue une reconnaissance détaillée du bois au nord du Haut-Poirier.
Le lieutenant BARTE-DEJEAN de la 3/10 passe comme adjoint technique à l’E.M. du bataillon et est remplacé par le sergent-chef LIFFRAN de la 1ère compagnie.
21 novembre 1939
La 1ère compagnie reconnaît le Grauberg, la 3e Cie le Feschenwald.
22 novembre 1939
Le capitaine BUISSON venu en renfort a été affecté à l’E.M. du bataillon.
Le lieutenant PATURLE officier de renseignement est évacué.
La 3e compagnie reconnaît le secteur D.A.R.E. en vue de la relève de la 2e Cie.
La 1ère compagnie reconnaît en détail la région du bois de Welferding.
23 novembre 1939
Reconnaissance par la 3e Cie de la zone du D.A.R.E. en vue de la relève.
24 - 25novembre 1939
Reconnaissances diverses et entretien du matériel pour les compagnies.
26 novembre 1939
Reconnaissance du chef de bataillon dans la région au Nord de Woelfing.
Rien de particulier pour les compagnies.
27 novembre 1939
La 1ère compagnie reconnaît la région de Richeling, Puttelange.
Les autres compagnies s’occupent à des travaux d’entretien.
28 novembre 1939
Reconnaissance de relève par les 2e et 3e compagnies.
La première compagnie reconnaît la région de Bettring, Holving.
29 novembre 1939
La 3e compagnie relève la 1ère à Wiesviller.
30 novembre 1939
La 1ère compagnie reconnaît 2 axes de repli au lieu de 3 précédemment fixés.
Les autres compagnies s’occupent à des travaux d’entretien, à l’instruction sur l’armement, ou au creusement de tranchées.
1er décembre 1939
Le lieutenant AZARD passe à l’E.M. comme officier de renseignement.
Reconnaissance de secteurs et travaux divers pour les compagnies.
2 décembre 1939
Le chef de bataillon reconnaît la région de Woelfing.
Les compagnies s’occupent à des reconnaissances et des travaux divers (entretien, tranchées, etc...).
13 décembre 2007
Instruction sur l’observation et l’appréciation des distances en char, exercice de conduite pour les 2e mécaniciens. Réinstallation des groupes de D.C.A.
Un coup de main ennemi sur le P.P. du bois de Brandenbusch a réussi.
Les occupants ont été faits prisonniers à l’exception de deux blessés laissés pour morts.
14 décembre 1939
Reconnaissances et causeries diverses.
15 décembre 1939
Même travaux que la veille.
16 décembre 1939
Le capitaine BOREAU de RONCÉ qui doit prendre le commandement de la 3/10 rejoint le bataillon.
La 3e compagnie fait dans la nuit mouvement de Wiesviller à Sarreinsming à la suite d’un coup de main allemand dans le bois de Bliesguerviller.
17 décembre 1939
Le capitaine BOREAU de ROINCÉ prend le commandement de la 3e Cie. Cette compagnie effectue des reconnaissances dans la zone Sarreinsming – Neukirch – Bois de Bligerschviller en vue d’une contre-attaque éventuelle dans la boucle de la Blies.
18 décembre 1939
Entretien au matériel, reconnaissances et travaux de traction pour les Cies FT.
19 décembre 1939
La 3e Cie fait mouvement de Sarreinsming à Wiesviller.
Les autres compagnies font de l’instruction et entretiennent le matériel.
20 décembre 1939
Même travaux que la veille.
L’après-midi l’officier de renseignement au groupe et l’officier de renseignement du 10e B.C.C. font de l’observation avec la binoculaire du groupe dans les combles d’une maison de Welferding.
Ils surveillent le village d’Hanweiler et Hitlerdorf sans résultat.
21 – 22 décembre 1939
Travaux habituels.
24 décembre 1939
Travaux ordinaires et préparation des fêtes de Noël.
Samedi 13 janvier 1940
Travaux d’entretien, instruction du personnel,
Dimanche 14 janvier 1940
Reconnaissance d’un cantonnement pour le 10e bataillon par le lieutenant-colonel commandant le groupe de chars 504 et le commandant du 10e bataillon : régions : Moussey Remoncourt Xousse.
Lundi 15 janvier 1940
Le 10e bataillon effectue un mouvement et se rend dans la région de : Moussey Remoncourt Xousse Lagarde. (La 3e compagnie se rend de Domfessel dans la région de Moussey).
Mardi 16 janvier 1940
La 1ère compagnie du 10e bataillon effectue son mouvement et se rend dans la région de Moussey.
Le capitaine adjoint technique effectue une reconnaissance dans les régions : Saint Jean de Rohrbach Puttelange Rémering Grundviller Heckenransbach et ferme chneknenbrukt.
Mercredi 17 janvier 1940
Le lieutenant-colonel commandant le G.B.C. 504 se rend au P.C. du commandant du 10e bataillon à Moussey
Jeudi 18 janvier 1940
Démonstrations devant des journalistes étrangers, scandinaves.
Le commandant adjoint technique effectue une reconnaissance : Hambach – Heckenransbach – Grundviller.
Lundi 22 janvier 1940 :
Le lieutenant-colonel commandant le G.B.C. 504 se rend au P.C. du commandant du 10e B.C.C.
Instructions et travaux divers d’entretien pour le bataillon.
Par note de service, le général QUILLOT notifie au lieutenant-colonel commandant le G.B.C. 504 de prendre sous son commandement les 10e et 24e bataillons, la C.T. n°79.
Le 10e étant stationné à Moussey – Xousse – Remoncourt passe en réserve du G.Q.G.
26 janvier 1940
Entretien du matériel, instruction pour le 10e bataillon.
28 janvier 1940 :
Arrivé au 10e bataillon d’un renfort comprenant 1 officier, 1 caporal-chef et 38 chasseurs.
Les chars désarmés stationnés à la Ferme Strohhof pour lesquels il avait été donné l’ordre de les transporter à Dieuze sont amenés à Herbitzheim.
29 janvier 1940
Instruction pour le 10e bataillon.
30 janvier 1940
Pour le 10e bataillon rien de particulier.
Mercredi 31 janvier 1940
Au 10e bataillon, instruction et entretien du matériel.
15 février 1940
Pour les bataillons, entretien du matériel et reconnaissance.
28 février 1940
Recherche avec l’officier de renseignement du 10e bataillon d’un terrain de manœuvre dans la région de Lunéville.
29 février au 9 mars 1940
Essais de passage de ruisseau au moyen de fascines, exercice auquel assistent le lieutenant-colonel du G.B.C. 504 et le capitaine chef de l’E.M. Le lieutenant-colonel du CHOUCHET prend le commandement des chars de l’armée en l’absence du général GUILLOT partant en permission.
Le 2 mars 1940, création de la 3e DCR à Chatou (Seine) aux ordres du Général Brocard puis du général Buisson à partir du 15 mai 1940.
Le 10e BCC entre dans la composition de la nouvelle division.
Le 10e bataillon va cantonner à Blâmont afin de prendre part à des exercices sous la direction du colonel commandant les chars de la Ve armée.
1er avril 1940
Le colonel et le lieutenant VIDAL se rendent à Blâmont, où le 10e B.C.C. exécute des exercices de franchissement de ruisseaux avec l’appareil «lance-fascines» type Ve Armée.
7 avril 1940
Le 10e B.C.C. revient de Blâmont et réoccupe ses cantonnements de Moussey et environs.
11 avril 1940
Le commandant du 10e B.C.C. et les officiers de renseignement du GBC504 et du 10e B.C.C. se rendent aux P.C. de la 52e D.I. à Sarre-Union et de la 87e D.I.A. à Altviller pour prendre liaison en vue des reconnaissances à effectuer par les cadres du 10e B.C.C. dans leurs secteurs respectifs.
12 avril 1940
Le colonel visite les cantonnements du 10e B.C.C. à Moussey, Xousse et Remoncourt, et se fait présenter 3 officiers Polonais affectés au bataillon.
Liaison avec les chars de l’Armée et la 82e D.I.A. à Lunéville.
14 avril 1940
Ordre donné au 10e B.C.C. de se préparer à quitter ses cantonnements.
La 2ème compagnie (capitaine LEFORT) fait mouvement dans la nuit du 14 au 15 et s’installe à Insming.
15 avril 1940
L’Etat-major du 10ème B.C.C., la 1ère compagnie (capitaine TANCREDI) et la 3ème (capitaine de ROINCÉ) font mouvement dans la soirée et s’installent à Albestroff.
L’officier de renseignement du groupe et le commandant du 10e se rendent au P.C. de la 14ème D.I. à Hellimer.
16 avril 1940
La CE/10 est maintenue provisoirement à Moussey. La 1/10 s’installe par ordre du C.A. à Schneckenbusch.
18 avril 1940
Le colonel et le lieutenant VIDAL va voir à la ferme de Schneckenbusch la 1ère Cie du 10e qui s’y installe dans la soirée du 16.
Le général GUILLOT commandant les chars de la IVe Armée, accompagné de l’ingénieur chef de 1ère classe BRICARD, du service des recherches scientifiques et techniques du ministère de l’armement, du major GALDUIG de l’armée Britannique, du capitaine PICARD, officier de liaison de l’inspection générale des chars avec le service des recherches scientifiques, et du lieutenant MOREAU de son état-major viennent assister à Torcheville à des exercices de franchissement de ruisseaux à l’aide d’appareils lance-fascines (type 10e B.C.C. et Ve Armée) exécutés par le 10e B.C.C.
1er mai 1940
La section de transport et la section de dépannage du 10e B.C.C. se rendent à Hoste Haut pour embarquer et transporter à Dieuze les 6 chars FT utilisés comme tracteurs.
Inspection de la 1ère Cie du 10e B.C.C. à la ferme Schneckenbruhl par le GBC504
5 mai 1940
Visite de l’ouvrage du Haut-Poirier par les officiers Polonais en stage au 10e B.C.C. Assistent également à cette visite le capitaine BUISSON, les lieutenants PESSEL et YVERT du 10e B.C.C. et l’officier de renseignement du groupe.
Au cours de la nuit du 4 au 5 mai, la Cie de chars de Scneckenbruhl a été mise en état d’alerte par le général commandant le D.A.R.D. L’alerte prend fin à 6h00 du matin.
Le chef de bataillon commandant le 10e B.C.C. et l’officier de renseignement se rendent à la ferme Schnekenbrühl pour mettre au courant de sa nouvelle mission le capitaine commandant la 1/10.
6 mai 1940
Le chef de bataillon, le lieutenant VIDAL et les cadres de la 1/10 exécutent la reconnaissance prescrite la veille au soir par le général commandant le 20e C.A.
12 mai 1940
La 1ère compagnie du 10e B.C.C. en stationnement à la ferme Schneckenbrüll est alertée à 11 heures par le général commandant le D.A.R.O. en raison d’une poussée allemande accompagnée de violents tirs d’artillerie.
La compagnie prend une position d’attente dans le Kehlwald (1 km au sud de Hundling).
A 21 heures, la 1ère compagnie regagne les bois de Schneckenbrülh.
L’attaque allemande a progressé jusqu’au ruisseau de Lixing.
Les postes avancés du D.A.R.O. ont été enlevés.
Le C.A. n’a pas assez de réserves pour reprendre le terrain perdu. Les chars n’ont pas été engagés.
Le capitaine TANCREDI reprend son emplacement dans le Kehlwald.
Le 10e B.C.C. reçoit l’ordre de se préparer à embarquer en chemin de fer à la gare de Léning.
Les véhicules sur roues partent par voie de terre, destination inconnue.
Débarquement à Consenvoye (Meuse).
23 - 24 mai 1940
Intervention dans la zone Saint-Pierremont – Sommauthe en soutien des troupes coloniales.
Le 26 mai 1940, le bataillon se trouve en soutien des 35e et 36e divisions d’infanterie au nord de Oizy pour participer à ce qui est rapidement qualifié de "bataille de l’Aisne".
Le 1er juin 1940, on retrouve le bataillon entre Briquenay et Vouziers à Longwy.
Le bataillon gagne la région de Sémide. Il est intégré dans le Groupement Buisson.
Le 10 juin 1940, regroupé au sud de la rivière Retourne, le 10e BCC attaque sur l’axe Menil-Lépinois - Alincourt - Le Châtelet mais est pris à partie par l’avant-garde de la 1ère Panzers. Les combats tournent à l’avantage des Allemands. Usés, ils doivent marquer une pause qui permet aux troupes de la 7e DLM de se regrouper à La Neuville. Dans cette affrontement le 10e BCC laissera de nombreux chars, la 2e compagnie est pratiquement anéantie.
La contre attaque ayant échoué la retraite devient inévitable.
Repli avec la 3e DCR.
Combats près de la ferme du Piémont.
13 juin 1940
En position sur la Marne à Drosnay
14 juin 1940
Repli vers Brienne-le-Château puis Châtillon sur Seine.
Les chars restants sont intégrés au 42e BCC.
23 juin 1940
Le bataillon qui avait été rattaché en catastrophe à la 7e DLM le 8 juin en 1940 revient à son dépôt de Valence et constitue le 23 juin une compagnie de marche de chars B dans la région de Bollène où l’armistice l’atteint le 25 juin.
En vertu des accords d’armistice le 10e Bataillon de Chars de Combat Alpin sera dissout fin juin 1940.
|
|
Historique du
9e Bataillon de Chars de Combat |
Le 9e BCC est créé le 19 août 1939 à Verdun à partir du 1er Bataillon du 511e Régiment de Chars de Combat.
Cette nouvelle unité, équipée de 45 chars R 35, aux ordres du commandant Gauthier est rattachée administrativement au 511e Groupe de Bataillons de Chars de Combat (GBCC) et affectée à la IIIe armée.
Le 16 janvier 1940 le 9e BCC rejoint le 510e GBCC à la VIIe armée.
Avec cette grande unité il participe à l’expédition en territoire Hollandais dans le cadre du plan "Breda- Dyle".
Le 13 mai 1940, la VIIe Armée à partir de la région de Breda - Tilburg se replie vers le nord-est de la Belgique, entre en contact avec la 9e panzerdivision et retraite ensuite vers la France avec des éléments de la IXe Armée pour se positionner près du Quesnoy.
Le 16 mai, le général Giraud remplace le général Corap. La 9e Armée n’est plus, ses restes fusionnent avec la 7e Armée.
Le 9e BCC tout en combattant se dirige en direction du nord-ouest sur un axe Lens - Béthune.
Le 22 mai 1940, le Général Tarit, commandant la 1ère DINA depuis le 15 janvier 1940, regroupe les débris de sa division: 5e RTM, 28e RTT, 27e RTA, 54e et 254e RA et GRDI 91 auquel se joignent trois compagnies du 9e BCC.
Ce nouveau groupement tient Béthune et le 23 mai va prendre position derrière le Canal Le Hamel – Cornet - Malo.
Le 23 mai 1940, au court de ce repli près de Saint-Hilaire-Cottes une première escarmouche met aux prises un Kampfgruppe de Waffen SS et les derniers éléments de la colonne blindée composée de chars du 9e et 22e BCC.
Quelques kilomètres plus loin, pénétrant dans Aires sur Lys, les chars sont piégés en pleine ville où après un intense combat de rues de nombreux R 35 sont détruits. Seuls 11 chars échapperont au désastre (dont 5 seulement en état de combattre) et iront se positionner à Hazebrouk.
Le 24 mai 1940, les restes du 9e BCC stationnent à Rosendaël puis le 28 mai à la ferme Brandler où le bataillon partage ses cantonnements avec des éléments du 39e BCC.
Le 28 mai 1940, avant le départ de l’unité pour Malo-les-Bains pour un éventuel embarquement pour l’Angleterre, les chars sont sabotés.
Ce n’est que le 30 mai que les survivants du 9e bataillon de chars de combat embarquent pour Douvres sur "l'IMPETUEUSE".
A partir de Southampton ils seront dirigés ensuite sur Cherbourg le 1er juin 1940 sur le paquebot "BRUGES". A leur arrivée ils y retrouveront les éléments roues de leur bataillon qui avaient échappé à l’encerclement de la poche de Dunkerque.
Le 15 juin, ce sera Champagnac, le 21 Bergerac, le 23 Mouly puis Auch où le bataillon sera dissout.
 |
8e RÉGIMENT DE CUIRASSIERS
SOUVENIRS DE L'AUTOMITRAILLEUSE DE DÉCOUVERTE PANHARD 178 - N° 99828
|
Je suis née en 1938 dans les usines Panhard et immatriculée sous le n° 99828.
Je fus affectée au 2e peloton du 3e escadron du 8e Régiment de Cuirassiers motorisés et Saint-Germain-en-Laye pour remplacer une A.M.D. LAFFLY-VINCENNES.
Après être passée à l’atelier du régiment où l’on me dessina une croix de Lorraine, insigne de la 2e Division Légère Mécanique, et un cœur vert bordé de blanc de chaque côté de mon blindage pour figurer le cœur du 2e peloton, le vert du 3e escadron, je fis la connaissance de mon premier équipage. Il était composé d’un chef de voiture, maréchal des logis Rezzi, d’un conducteur cuirassier Simonetti, d’un tireur cuirassier Bora et d’un inverseur cuirassier Sansonnet ? Ensemble nous fîmes de belles promenades dans la région de Saint-Germain-en-Laye, par exemple à Saint Nom la Bretèche, Feucherolles, les Alluets-le- Roi- Plaisir-Grignon.
J’ai participé avec quelques-unes de mes sœurs à l’inauguration de la place Hoche, à Versailles. J’ai fait partie d’une présentation de matériel à Satory devant tout un aréopage de ministres et de généraux et où le "présentateur" était un certain colonel de Gaulle. On m’a également présenté à la promotion 1938 de l'Ecole de Saint-Cyr. Le 14 juillet 1939, j’ai défilé fièrement sur les Champs Elysées avec tout le régiment et bien d’autres unités devant leurs Majestés le roi et la reine d’Angleterre et j’ai eu l’occasion de caresser légèrement et involontairement un cheval de la garde, qui ne fit même pas un écart. J’ai encore eu l’occasion de faire deux choses amusantes : la première un exercice d’embarquement sur wagon de chemin de fer ; la seconde une traversée de rivière sur un pont de bateaux installé par le Génie. Puis ce furent les grandes manœuvres du mois d’août 1939 où mon tireur a fait une magistrale démonstration de son flegme et de sa précision, tant à la cible fixe qu’à la cible mobile. Hélas, nous avons dû rentrer précipitamment au quartier avant la fin de ces manœuvres.
Sur la route des informations, nous arrivaient par bribes - j’entendais “Le Président du Conseil rencontre le Premier ministre britannique - la mobilisation n’est pas la guerre - Hitler ne bougera pas". A Saint-Germain, le quartier était en effervescence. Je repartis après quelques jours, mais sans mon chef de voiture qui avait été remplacé par le maréchal des logis Rosset, afin de lui permettre d’aider le sous-lieutenant Samson à organiser l’échelon B du 2e escadron. J’ai récupéré mon chef de voiture à Villeret, dans l'Aisne. Nous avons cantonné à Villeret-Nauroy Beaurepaire et, après un état d’alerte le 11 Novembre, à Vieux Rang. Puis, nous sommes arrivés à Louvroil près de Maubeuge et avons passé un hiver extrêmement rigoureux à Prisches. Le printemps est revenu et la drôle de guerre s’est achevée le 10 mai 1940, sans que quelque chose de notable soit à rapporter pendant cette période, sauf toutefois, un changement dans l’équipage. Après le départ de Simonetti pour une autre formation, Sansonnet a été promu conducteur et l’équipage a été complété par Ponsardin au poste d’inverseur, Bora restant au tir.
10 mai 1940, 4 heures, alerte, 5 heures 30, rassemblement des officiers et des chefs de voiture chez le capitaine Potier, commandant l’escadron. Les allemands sont entrés en Belgique et en Hollande depuis ce matin 3 heures. Tous les véhicules au chargement : armement, munitions, plein d’essence.
10h20 : rassemblement.
10h50 mission pour notre patrouille reconnaissance et action retardatrice sur l’axe Liège Namur, tenir cinq jours.
11h00 départ, nous quittons Prisches. Le sous-lieutenant Samson en permission, c’est le capitaine Potier qui prend le commandement du détachement. Ce détachement est formé d’une première patrouille comprenant l’A.M.D. du maréchal des logis Salle, un groupe moto et l’A.M.D. du brigadier-chef Poupault, d’un groupe PC. comprenant la voiture radio du capitaine et trois agents de liaison moto, d’une deuxième patrouille comprenant moi-même avec le maréchal des logis Roui, un groupe moto sous les ordres du sous-lieutenant de Feuillade et l’A.M.D. du brigadier-chef Vermet.
13h00 après être passé à Landrecies, Maroilles, Louvroil, Maubeuge, nous rentrons en Belgique. L’accueil est enthousiaste.
17h15, Gembloux, nous réquisitionnons un plein d’essence à une station service. Les stukas bombardent la gare et l’usine à gaz. Ça fait un bruit infernal de sirène et d’explosions. C’est, paraît-il, le baptême du feu et du feu y en a partout.
11 mai, pas de ravitaillement, le maréchal des logis achète des oranges, c’est tout ce qu’il y aura à manger et à boire pour l’équipage. Par contre, il ne manquera pas de cigarettes généreusement offertes par les habitants des pays traversés.
9h10, rassemblement, direction Liège.
13h00 Voroux, Goreux, à une dizaine de kilomètres de Liège, le capitaine me désigne pour faire une reconnaissance sur Liège accompagnée par le side-car du maréchal des logis Ropars. Nous voyons pour la première fois des cadavres, des civils, hommes femmes, enfants, ils sont là 7 ou 8, fauchés le long du talus. C’est la pagaille, armée belge, les civils refluent dans un désordre indescriptible. Des chevaux morts nous barrent la route, je passe dessus - quelle horreur- un gamin blessé pleure sur le cadavre de sa mère. Liège est bombardé presque sans discontinuer depuis 3h00 ce matin. Les allemands sont dans la ville. Nous les voyons. Ropars va rendre compte. Je fais demi tour. Nous sommes mitraillés par l’aviation. Pas de dégât. Retour à Voroux. On se replie. Je ne démarre pas. Un motard signale ma panne. La voiture radio du maréchal des logis Cochin vient me dépanner. A entrée d’Huy, dans la nuit, le capitaine me laisse aux ordres du 1er Dragons pour garder un pont qui doit sauter.
12 mai, le pont ne saute pas. Le Génie attend les ordres. L’ennemi est en face. Cinq tirs de 25 et trois rafales de mitrailleuse sur un véhicule léger qui fait demi-tour. Plus rien.
13 mai, 6h00, l‘équipage a passé une mauvaise nuit. Des éléments du 1er Dragons, du 8e Zouaves et dont ne sait trop quelles unités sont passées jusqu’à 3h00 du matin, plus ou moins mélangés aux civils qui fuient. Depuis plus rien ne passe. Calme plat. A 6h00 essai de démarrage, rien à faire, c’est la panne. Des coups de feu sont tirés derrière nous. Le pont est toujours là. Le Génie est parti. Les allemands ne se montrent pas. Les Dragons décrochent. Ils vont signaler ma panne. Pas de ravitaillement. Rien ne bouge. C’est angoissant. 14h00 l’A.M.D. du brigadier-chef Poupault arrive à notre hauteur. Il nous a fait peur, mais me prend en remorque. Nous décrochons.
14 mai, nous avons perdu notre détachement. Nous marchons en direction de Namur, 8h00, nous rencontrons le général Lacroix, commandant la 4e B.L.M. Le maréchal des logis lui rend compte des positions allemandes. Il nous envoie porter un pli au capitaine de La Barrière, 1er Dragons, à Courcelles. Le général nous apprend que le sous-lieutenant Samson a été tué. C’était notre chef de peloton.
9h00, nous sommes aux ordres du capitaine de La Barrière. On me répare (démarreur grippé).
10h00, chars allemands en vue, ils sont trois. Nous les stoppons. Il semble que l’ennemi ne cherche pas le combat.
17h00, les SOMUA nous relèvent.
15 mai, j’escorte un convoi du Génie. 17h00 garde au P.C. du général.
16 mai, au matin les chars allemands approchent, ordre de repli. Je retombe en panne. Réparation. Saleté de démarreur. Nous avons perdu la colonne. Direction Namur. Personne devant, personne derrière. Nous passons la nuit dans un bois. Pas de ravitaillement. Plus beaucoup d’essence.
17 mai, 3h00 du matin. Des chars Hotchkiss arrivent sur nous, heureusement que Bora n’a pas tiré. Nous mettons aux ordres d’un commandant du 29e Dragons.
10h00, nous approchons de Namur. Les belges nous tirent dessus. Nous agitons nos fanions. Le terrain est miné. Les allemands sont tout près. Les Hotchkiss et nous, tirons sur la lisière d’un bois à 200 mètres. La réplique est immédiate. Un char du 29e est touché. Nous restons à couvert tout en arrosant la lisière toutes les 10 mn.
14h10, rassemblement. 14h25, nous entrons dans Namur. Pas de 8e Cuirs. Toilette pour les hommes, plein d’essence pour moi, repas enfin pour eux. 16h00, trente chars allemands signalés dans Namur, paraît-il. Est-ce vrai ?
18 mai, nous sommes à nouveau aux ordres du capitaine de La Barrière, 1er Dragons. Nous quittons Namur, direction Wepion, Fraire, Chastres. Les allemands sont partout, il faut se battre, c’est dur.
19 mai, nous passons la frontière à Hestrud
17h05. Une voiture légère me fait signe de la suivre. C’est le colonel Mono. Enfin, nous retrouvons le 8e Cuirs à 19h20 au château de Berelles. Nous sommes aux ordres du lieutenant Du Bois Péan. Je marche mal.
22h00, Départ, je prends position à Louvroil.
20 mai, 6h20. Un char Hotchkiss arrive en renfort, je suis à défilement de tourelle à gauche de la rue. Le char se poste à droite. 7h05 un char allemand arrive face à nous à 25 m, canons et mitrailleuses crachent. Il est surpris. Il semble qu’il ne puisse manœuvrer. Feu. Feu. Lui tire sur le char Hotchkiss. Il n’a pas pu me voir. Vas-y Bora continue, il ne peut plus bouger. Des hommes tentent de sortir. Notre mitrailleuse arrose à tout va. Le char Hotchkiss en fait autant. Le calme revient. Combien de temps a duré le combat, je ne sais. Le lieutenant Caboat arrive en side-car, personne ne bouge. Il va jusqu’au char allemand, fait une rapide inspection et revient, au passage il lance "bon travail" et repart. Nous, nous restons. Un agent de liaison moto nous apprend que le maréchal des logis Cochin vient d’être tué. Il est midi.
11h30, repli. Direction Cambrai, Bavay est en flamme, Valenciennes, Saint-Amand, Orchies.
18h00, Douai. Réfugiés et troupes sont mélangés. C’est la pagaille. Je perds la colonne. Un sous-officier du 75e GRDI nous arrête. Il informe que les allemands sont dans Cambrai. Nous recherchons le détachement et ne pouvons guère avancer à cause des encombrements, c’est désolant. 7 km avant Cambrai rencontre avec le capitaine de Bourboulon et ses camions. Cambrai est prise. Nous retrouvons la colonne, direction le château de Gouy-sousBois. Il fait nuit.
21 mai, matin, direction Vitry en Artois. Je suis de garde sur un pont, sous les ordres du sous-lieutenant de Feuillade. Nous sommes bombardés, le terrain d’aviation est salement touché. Heureusement que mon plein a été fait avant le bombardement du terrain.
22 mai. Garde au PC. du colonel. RAS.
23 mai. Garde au PC. du colonel. RAS.
24 mai. Sainghin, l'équipage peut faire une espèce de repas et un peu de toilette. 21h30 reconnaissance sur Arras aux ordres du lieutenant Du Bois Péans. Arrêt à Bailleul, Sire, Bertoult.
25 mai. Reconnaissance sur Thelus, Neuville, St Vaast, Mont St-Eloi, Camblai Abbé. Les allemands sont dans Arras. Retour à Sainghin. Après-midi félicitations du général Blanchard. Pourquoi ? . . Le général Bougrain informe que l’armée du nord est encerclée. Passerons-nous à Cambrai ?
26 mai. 7h00. alerte. 7h30, départ direction nord et Cambrai ? 7h40, arrêt les chefs de voitures au lieutenant - itinéraire Carvin, Hénin, Liétard, Lens, La Bassée, Fourmies, Armentières, Ypres, qu’est-ce que ça veut dire ? - les belges ont demandé l’armistice.
9h40. Nous entrons à nouveau en Belgique. Lens et Armentières sont en flammes. A Ypres, nous allons en direction de Meenen. Arrêt à Geluveld. Il n’y a personne, tout est calme. Pour moi, reconnaissance sur Meenen. Voir et rendre compte. Il est 13h05.
A Geluwe contact avec les allemands. Canons, mitrailleuses. Ils se replient, nous continuons. Nous voyons à Meenen, une très importante colonne allemande qui se dirige en direction de Tourcoing. Des automitrailleuses, des camions, des motos, ils vont vite. Un temps mort, puis arrive un petit convoi. Nous tirons, ils n’ont pas l'air de nous localiser. Feu. Feu, deux automitrailleuses et trois motos semblent rester au tapis. Je décroche et vais rendre compte.
17h30, nous sommes attaqués. Le 1er Dragons est avec nous.
18h10, trois chars allemands se présentent à 350 m environ. Feu. On nous bombarde, un éclat fait une coupure au pouce droit de mon chef de voiture. Mon canon fait des coups au but à plusieurs reprises.
A la nuit, repli sur Ypres et direction la Bassée.
27 mai, nous avons passé la nuit à la Bassée. L’artillerie n’arrête pas de nous bombarder. Un obus tombe sur le PC. du colonel. Gobet est blessé aux jambes.
11h40, nous quittons la Bassée. L’aviation nous bombarde, mon aile avant droit est arrachée.
14h15, Vlamertinge. Nous sommes au contact Les allemands sont à 400 m. Mitrailleuse. Nous fonçons sur Poperinge.
29 mai. L’équipage et quelques soldats perdus font un méchoui dans un pré aux environs de Poperinge.
Un soldat anglais fait voir sa montre et dit bridge. Boum ! ... Nous nous dépêchons de passer. 14h00, nous avançons sur lsenberge. 15h05 les stukas nous attaquent. Trois blessés graves Garder, Plagnard et Ballet. Le camion des cantines est détruit. Adieu les affaires personnelles. Nous roulons de nuit vers Fumes. Ça bombarde de partout.
30 mai. La Panne (c’est un pays pas un gag). Des tas de véhicules sont abandonnés. Nous nous arrêtons. Toujours les stukas et les bombardements d’artillerie, ordre de saboter le matériel. La culasse du canon est démontée pour être jetée plus loin. Les mitrailleuses sont démontées, les pièces perdues dans les dunes. On me fait la vidange d’huile, tandis que mon moteur tourne. Je n’irai pas plus loin.
L’équipage s’éloigne et se dirige vers la mer. Malo, Dunkerque, peut-être ? . . . qui le sait. Ils ne se retournent pas mais je crois bien que plus d’un écrase une larme. Je vais mourir. Adieu.
A.M.D. 99823
Pour copie conforme
Raymond Rezzi (ancien du 8e Cuirassiers)
 |
LES OPÉRATIONS DU
8e BATAILLON DE CHARS DE COMBAT |
Le 8e bataillon de chars stationné au Camp de la Haute Moivre reçoit le 13 mai 1940 à 10 heures à l'ordre de se tenir prêt à faire mouvement.
Délais de préparation : 12 heures.
Le mouvement est prévu :
Par voie ferrée : Pour tous les chars, véhicules de commandement, tracteurs de ravitaillement et de dépannage, voitures de liaison, camions à vivres et bagages, cuisines roulantes.
Cinq trains pour le bataillon.
Par voie de terre : Les autres véhicules sur roues.
Les gares d'embarquement et itinéraires sont fixées le même jour à 19 heures.
Ordre de bataille à la date du 12 mai 1940
chef de bataillon GIRIER, commandant le bataillon.
État-major
chef d'état-major : Capitaine de Cugnac Dampierre.
officier adjoint technique : lieutenant Anglicheau.
officier de renseignements : lieutenant Souchon
officier des transmissions : sous-lieutenant Peschart d'Ambly.
officier des détails : sous-lieutenant Demangel
officier de liaison : sous-lieutenant Plattard.
médecin chef de service : médecin lieutenant Thuillier.
Section de commandement
adjudant chef Peche : radio, chef de la section de commandement.
sergent chef Fichaux : radio
sergent chef Teiturier : sous-officier conducteur
sergent chef Favier : sous-officier conducteur
sergent Droulers : secrétaire
sergent Kornmann : secrétaire.
1ère Compagnie
commandant de compagnie : lieutenant Dupont.
Section de commandement :
chef des transmissions : adjudant Gruselle, radio char commandement : sergent André, pilote char commandement : sergent Marteau.
adjoint au comptable : sergent Bitaudeau, sous-officier D.C.P. : sergent Esnault.
1ère section
a) officiers : lieutenant Hugot sous-lieutenant Adrian
b) sous-officiers : adjudant-chef Miclot sergent-chef Jambel sergent Mazue sergent Cadoux sergent Pestour
2e section
a) officiers : lieutenant Rosenwald sous-lieutenant Reveney aspirant Bridel
b) sous-officiers : sergent Lavaux sergent Baudy sergent Pizano sergent Delumeau
3e section
a) officiers : lieutenant Brayard sous-lieutenant Lutz
b) sous-officiers : sergent-chef Ott sergent Secroun sergent Roure sergent Erouret
section d'échelon
a) officiers : sous-lieutenant Le Corre lieutenant François
b) sous-officiers : adjudant Dick sergent-chef Trouillet sergent Girardot sergent Briva sergent Morisset
Caporaux-chefs : 13, caporaux : 16, chasseurs : 74
2e Compagnie
Commandant de la compagnie : capitaine Deyber
Section de commandement :
chef des transmissions : sergent chef Dijoux
radio char commandement : adjudant Poquet
adjoint au comptable : sergent Satinet
sous-officier D.C.A. : sergent Deschelles
1ère section
a) officiers : lieutenant Magrey sous-lieutenant Ferrand sous-lieutenant de Riberolles
b) sous-officiers : sergent Champeil sergent Voineau sergent Aubrie
2e section
a) officiers : lieutenant Bellanger sous-lieutenant Guérin sous-lieutenant Barthélémy
b) sous-officiers : sergent-chef Jeannod sergent Bidesheim sergent Ponsard sergent Diederle sergent Turbil
3e section
a) officiers : lieutenant Gandois sous-lieutenant Spreux
b) sous-officiers : sergent Letellier sergent Meritet sergent Braillard
section d'échelon :
a) officiers : lieutenant Gros
b) sous-officiers : adjudant-chef Watrinet adjudant Smouts sergent chef Barthélémy sergent Armatte sergent Higelin sergent Pivel sergent Vedovati
Caporaux-chefs : 12 Caporaux : 21 Chasseurs : 73
3e Compagnie
commandant de compagnie : capitaine Poupard
Section de commandement
chef des transmissions : sergent chef Curabet
pilote char commandement : adjudant Roy
adjoint au comptable : sergent Chouchena
sous-officier D.C.A. : sergent chef Robert
1ère section
a) officiers : lieutenant Lamoine sous-lieutenant Monier sous-lieutenant Bordeaux
b) sous-officiers : sergent Vieux Pernon sergent Dumonteil sergent Cuénin
2e section
a) officiers : sous-lieutenant Bernard sous-lieutenant Remy sous-lieutenant Serpeau
b) sous-officiers : sergent Dohle sergent Le Feuve sergent Dupretz sergent Cadet
3e section
a) officiers : lieutenant De Bretagne sous-lieutenant Pucel sous-lieutenant Beaugrand
b) sous-officiers : aspirant de Vigouroux d'Arvieu adjudant-chef Ousset sergent Mathieu
section d'échelon
a) officiers : lieutenant Caillat
b) sous-officiers : adjudant Dugeon sergent-chef Gaunand sergent Guyot sergent Feret sergent Vinckel
Caporaux-chefs : 21 caporaux : 20 chasseurs : 71
Compagnie d'échelon
commandant de compagnie : capitaine Robin
adjoint au commandant de compagnie : capitaine Ledur
1ère section : adjudant Feugère sergent Durand sergent Falaise sergent Rivoire sergent Lamaison
2e section : lieutenant Masson sous-lieutenant Babel adjudant-chef Folly sergent-chef Chavanton sergent-chef Guégan sergent-chef Vivier sergent Barlot sergent Brousseau sergent Droulin sergent Bougain sergent Cassard sergent ThibaudSergent Bastian
3e section : sous-lieutenant Robert sergent Wacker
4e section : lieutenant Nicolas adjudant Vexo sergent Charton sergent Ducornet sergent Naton
Caporaux-chefs : 9 caporaux : 19 chasseurs : 118
Sommaire des opérations
I - 13 au 18 mai : embarquement, débarquement, protection du repli des véhicules de la D.C.R. en forêt de Signy et défense des ponts de l'Aisne, de Rethel, de l'Oise et du canal Crozat.
II - 19 mai : combats de Ham.
III - 20 au 23 mai : regroupement des éléments et reconstitutions des unités.
IV - 24 au 25 mai : attaque de la tête de pont de Péronne.
V - 26 mai au 4 juin : mouvement de rocade Est Ouest et inversement, au sud de la Somme, dans le but de faire face à des attaques ennemies d'éléments blindés, débouchant des ponts de la Somme.
VI - 4 juin : attaque de la tête de pont d'Abbeville.
VII - 6 au 9 juin : mission retardatrice : reconnaissance et engagements divers : défense des ponts de l'Oise, de Sommereux, d'Auchy la Montagne, d'Agnetz et de la forêt de Hetz.
VIII - 10 au 25 juin : défense des ponts de Mery et de Mériel.
Mission retardatrice entre Seine et Loire
mission retardatrice entre la Loire et le Cher, défense des ponts de Quincy et Mehun sur Yèvre.
Mission retardatrice entre le Cher et la Creuse.
IX - pertes :
I- PÉRIODE DU 13 AU 18 MAI 1940
Le bataillon fait mouvement dans les conditions suivantes :
a) Par voie de terre : la majeure partie des véhicules sur roues du bataillon, sous les ordres du capitaine Robin, quitte le camp le 13 à 20h30, rejoint à Chalons les véhicules de la demi-brigade commandés par le capitaine Herbert et par Reims, atteint Laon, le 14 au matin. La colonne s'arrête quelques heures à Puisieux, repart à 18 heures sur Rozoy et atteint la forêt de Signy où elle se groupe avec la colonne sur roues du 15e B.C.C.
L'ensemble de tous les éléments sur roues de la 2e D.C.r. se trouve alors sous les ordres du lieutenant colonel Colhen.
b) Par voie ferrée : les éléments à embarquer sont groupés en 5 rames comprenant chacune :
1ère rame : état-major de la 2e demi-brigade, état-major du 8e B.C.C., six camions, les véhicules radio et de liaison de la brigade et du bataillon, la section de remplacement et le char de commandement du 8e B.C.C.
Commandant du train : chef de bataillon Girier
Embarquement : gare de Suippes, le 14 mai à 4h30
2e rame : matériel de la 1ère compagnie : chars T.L.R. véhicules chenillés, camions à vivres et à bagages, les voitures de liaison.
Commandant du train : lieutenant Dupont.
Embarquement : gare de Suippes, le 14 mai à 16h30
3e rame : matériel de la 2e compagnie (même composition que la deuxième rame)
Commandant du train : capitaine Deyber
Embarquement : gare de Suippes, le 15 mai à 3h30
4e rame : matériel de la 3e compagnie (même composition que la deuxième rame)
Commandant du train : capitaine Poupart
Embarquement : gare de Suippes, le 15 mai à 9h30
5e rame : Tracteurs de dépannage, camions atelier, camions citernes et quelques véhicules spéciaux de la C.E.
Commandant du train : capitaine Ledur
Embarquement : gare de Châlons-sur-Marne le 15 mai à 14 heures.
6e rame : rame de ramassage : pour les 8e et 15e bataillons et état-major de la brigade.
Commandant du train : lieutenant Anglicheau.
Embarquement : gare de Châlons le 15 mai à 12 heures.
Les débarquements, sauf pour les 1ères et 2èmes rames, n'ont pas lieu aux gares assignées.
La première rame débarque en gare de Hirson le 15 mai sans incident. (5h30).
La deuxième rame (1ère compagnie) débarque en gare de Hirson le 15 à 16h30 et reçoit quelques coups de feu provenant des maisons voisines de la gare.
La troisième rame (2e compagnie) débarque en gare de la Capelle le 16 à 10 heures.
La quatrième rame (3e compagnie) débarque le 16 à 17 heures en gare de Saint-Quentin.
La cinquième rame (C.E.) débarque à Saint-Quentin le 16 à 18 heures.
Les éléments débarqués de la première rame rejoignent la grande forêt de Signy où sont déjà groupés les véhicules de la colonne Robin.
Ces éléments arrivent dans la forêt vers 10 heures.
En passant à Maranvez, vers neuf heures, un capitaine d'artillerie signale au chef de bataillon Girier que le sud de la forêt de Signy est tenu par l'ennemi depuis plusieurs heures.
À 11 heures, la partie nord de la forêt est bombardée.
Vers 15h30 des militaires et des civils qui se replient en direction du sud de signalent que le village de Liard, dont plusieurs maisons sont en flammes, est occupé par l'ennemi et que les éléments légers ont été vus au nord-est de la forêt vers le carrefour de la Guinguette, progressant en direction de Signy.
À la même heure la section Robert reçoit l'ordre de se porter sans délai au nord de Wassigny. Les faits relatifs à son engagement sont consignés dans le rapport du lieutenant Robert.
Les dispositions de défense de la forêt sont immédiatement prises :
trois groupes de six motocyclistes, armés de mitrailleuses et de mousquetons sont formés et reçoivent l'ordre d'aller sans délai se porter l'un au nord de la forêt (cote 251), l'autre sur la côte de Merlemant (cote 255). Le 3e sur la route de la Saboterie (cote 228) avec mission d'interdire l'accès de la forêt.
Deux pièces de 75 tractées faisant partie d'un groupe qui se replie vers le sud sont stoppées sur la demande du capitaine de Cugnac commandant l'ensemble des trois groupes émis en batterie sur la route de Signy est à Marlement (côte 228).
Deux chars ennemis se présentent sur la route et sont détruits par le tir de ses pièces. Leurs débris barre le passage au reste de la colonne blindée qui descendait sur Signy.
Le repli vers le sud de tous les éléments bivouaqués en forêt commence à 17h30, en direction des bois de Paddois (point de 1ère destination). Les éléments qui font mouvement par petits groupes de cinq ou six véhicules se heurtent durant toute la nuit à des colonnes ennemies, en particulier sur la route de nationale Liard - Mersornet.
Tous les groupes qui n'ont pu être touchés par le chef de bataillon au cours de la nuit reçoivent l'ordre de se porter au sud de L'Aisne, dans les bois du Châtelet, où sont rassemblés le 16 dans la matinée. Quelques véhicules ont été détruits dans des embuscades tendues par l'ennemi, où n'ont pas pu rejoindre ce dernier point. Après regroupement, le commandant Girier établit au cours de la nuit, son PC au Châtelet.
Les éléments de combat des 1ère, 2e et 3e compagnie sont employés le 16 mai, au fur et à mesure de leur débarquement, sur l'ordre d'autorités militaires locales, à la défense fragmentaire des issues de Vervins, de Guise, et des ponts de l'Oise entre Guise et La Fère.
Plusieurs chars des 1ère et 3e compagnies sont détachées de leur unité et reçoivent directement d'un officier d'état-major de la IXe Armée des missions isolées entre Vervins, Guise, Seboncourt et Andigny.
Le 17 mai, le reste de la 1ère et 3e compagnies assure la défense des ponts de l'Oise, entre Origny inclus et La Fère. La section Robert est à Rethel, où elle est employée à la défense des ponts de l'Aisne.
À neuf heures, le chef de bataillon prend contact avec les éléments encore groupés des 1ère et 3e compagnies qui poursuivaient leur mission de défense de l'Oise, il les reporte dans la soirée sur le canal Crozat.
Il n'aura désormais plus aucune nouvelle des éléments de combat de la 2e compagnie restés au bois d'Etaves et Bocquiau, avec une section de la 3e compagnie, ni des cinq chars de la 1ère compagnie, qui avaient reçu des missions isolées.
À 21 heures, les éléments regroupés du 8e bataillon quittent les ponts du Canal Crozat, et arrivent à Cuy, 7 km ouest de Noyon où ils stationnent le 18 mai.
Dans la nuit du 18 au 19, ils se portent vers Ham par Guiscard où les pleins (munitions et essence) sont complétés le 19 vers 3h30.
II - 19 MAI - COMBATS DE HAM
Un détachement comprenant :
7 chars B1 bis du 15e B.C.C.
5 chars B1 bis du 8e B.C.C. reçoit la double mission suivante :
1° dégager la ville de Ham
2° pousser en direction nord-est au sud de Saint-Quentin, sur la route de Ham à Saint-Quentin entre le canal Crozat au nord et la vallée de l'Oise au sud sur l'axe Ham, Ersigny, Urvillers, Itancourt, Neuville Saint-Laurent où elle doit s'installer défensivement et attendre l'infanterie chargée d'occuper ce point.
Le détachement quitte Cury le 19 mai à une heure, complète ses pleins à Guiscard entre 2h30 et 3h30 et arrive à Ham - sortie sud du village, à sept heures.
Le colonel Roche, commandant la brigade et le chef de bataillon Girier prennent contact avec le commandant du G.R.D.I. et le commandant du bataillon du 141e R.I. qui occupent le sud de la voie ferrée, Ham étant déjà aux mains de l'ennemi.
L'heure H est fixée à huit heures.
Pour l'attaque, la colonne est fractionnée en deux échelons.
1° échelon : une compagnie à 9 chars B1 bis, sous le commandement du capitaine Vaudremont,
2° échelon : une section réservée de 3 chars B1 bis commandée par le lieutenant Lamoine.
La compagnie de premier échelon démonte et traverse le barrage établi sur le pont du canal par le G.R.D.I. et capture une vingtaine d'Allemands.
La rue principale est barrée par des voitures garnies de mines.
Un passage est ménagé sur le trottoir, il est miné. Les équipages de tête détruit au canon et à la mitrailleuse, un certain nombre de mines, les prisonniers allemands enlèvent le reste.
L'ennemi met le feu aux voitures du barrage et les chars ne peuvent le franchir que vers 9h30. Dès leur débouché, ils sont pris à partie par un canon de 47 français et un 37 Allemand.
Ces deux pièces sont détruites par les chars de tête. Des grenades sont lancées les fenêtres. Les mitrailleuses des chars font cesser cet envoi.
Des antichars sont postés dans les rues latérales. La compagnie fait un circuit fermé pour nettoyer la ville et se regroupe. Le char de tête, à court de munitions, se fait relayer par le suivant. La compagnie repart suivi de quelques motocyclistes du G.R.D.I. Elle est à nouveau prise à partie par des antichars, en détruit cinq, plus un canon automoteur chenillé à long tube.
Un char B signale par radio que son radiateur est percé. Un autre, que son barbotin est endommagé. Deux autres sont également atteints.
Le char de tête est à nouveau relayé et la compagnie reprend sa progression dans les rues de Ham.
À la sortie nord-ouest du village, nouveau barrage battu par des antichars de gros calibre. Un antichars est détruit, des voitures de tourisme qui fuient sont prises en chasse à la mitrailleuse.
Le barrage subsiste ; les motocyclistes se replient : il est 12 heures.
L'essence et les munitions touchent à leur fin, l'infanterie n'a pu suivre et l'ordre de ralliement des chars à la P.R. est donné à midi. Un char du 15e B.C.C. est remorqué sur la P.R. par un char du 8e. Le retour s'effectue sans perte. Trois chars sont laissés en surveillance derrière le barrage français à 300 m au sud de la voie ferrée, les autres sont repliés sur Guiscard. L'un d'eux casse son barbotin gauche et est immobilisé à 1,5 km au sud de Ham, sur la route Ham - Guiscard.
Vers 18 heures, 24 bombardiers ennemis attaquent en piqué les chars maintenus au sud de la voie ferrée et, malgré la durée et la violence du bombardement, aucun dégât, ni aux matériels ni aux équipages.
L'incendie de Ham continue jusqu'au soir du 20 mai.
Le bombardement terminé, les chars et un canon de 75 en position à proximité détruisent un observatoire qui réglait les tirs de l'artillerie ennemie, celle-ci reprend dans l'après-midi du 19, le bombardement des chars postés et le continue le lendemain 20.
Dans l'après-midi du 20 mai, l'ordre est donné au commandant du G.R.D.I. de faire sauter le pont du canal qui est détruit, et les trois chars se replient, la nuit venue tandis que s'éteignait l'incendie de la ville.
La section Robert tient toujours à Rethel qu'elle ne quittera que le 22 mai.
III - PERIODE DU 21 AU 23 MAI
Les éléments des 8e et 15e bataillons sont regroupés au sud de la forêt de Compiègne où ils stationnent dans les bois du Roi, au sud de Crépy en Valois.
Le 8e bataillon reçoit en renfort en plus des éléments du 15e bataillon, les compagnies 347, 349 et 351.
Tous les éléments qui forment le bataillon de marche 8/15 quittent le bois du Roi le 22 mai pour Cury où ils arrivent le 23 mai vers quatre heures, sauf la 347e (chars B1) qui ne peut rejoindre.
Départ de Cury, le 23 mai à 20 heures.
Point de première destination : Roiglise où les ordres sont donnés dans le colonel commandant la 2e demi-brigade cuirassée pour la constitution de 3 groupements tactiques et pour les dispositions à prendre en vue des opérations projetées au sud de Péronne.
IV - PERIODE DU 24 AU 25 MAI 1940 - ATTAQUES AU SUD DE PERRONE
24 mai : combats de Villers Carbonnel - Pont les Brie
25 mai : combats de Licourt - Epenancourt
24 mai :
Un groupement tactique est constitué le 24 mai.
Il comprend :
L'état-major du 8e bataillon de chars.
Une compagnie de chars légers (2e compagnie du 40e bataillon).
Une section de chars B1 bis (349e compagnie).
Une compagnie de chasseurs portés (1ère compagnie du 17e B.C.P.), capitaine Bouff.
Un canon de 25, deux canons de 47 (batterie antichars divisionnaire).
Ce groupement a pour mission de s'emparer de Villers Carbonnel et de Pont les Brie, de détruire toutes les résistances qui s'opposeraient à sa progression et de permettre à l'infanterie de s'installer définitivement sur ces deux points importants.
La colonne est fractionnée comme suit :
une section de R 35
une section de B1 bis
deux sections de R 35 dont une avec pour mission de protéger au nord le débarquement des chasseurs à Villers Carbonnel.
une compagnie de chasseurs portés renforcée d'un canon de 25 et d'une section de canons de 47.
Le PC du bataillon avec deux chars B1 bis de commandement.
Une section de R 35 réservée.
Le déroulement des opérations s'effectue dans les conditions ci-après :
Départ à six heures.
Les éléments de tête abordent le dispositif ennemi à la sortie nord de Marchelepot à hauteur de la station à 7h30.
Progressant sur la route de Fresne - Mazancourt, la colonne réduit plusieurs centres de résistance (armes antichars et armes automatiques) en batterie aux lisières sud des bois à 800 m nord-ouest de Marchelepot, à la cote 90 et dans les bois à l'est de la route nationale Roy - Peronne à hauteur de Misery.
Plusieurs groupes ennemis fuient en hâte en direction nord, partie à pied, partie en camions et se dirigent vers Villers Carbonnel et Pont les Brie. Fresne-Mazaucourt est abordé à huit heures. Les éléments qui occupent le village sont rapidement maîtrisés.
À 8h30 Villers Carbonnel est atteint. Ce village est très fortement tenu : de nombreuses armes antichars et armes automatiques installées au grand carrefour de la route de Saint-Quentin sont anéanties. Les premiers éléments de chasseurs portés peuvent débarquer sans trop de difficultés aux lisières sud du village sous la protection de la section de chars R 35 qui a gagné les lisières nord et est.
Des observateurs du G.R.D.I. installés dans le clocher de Marchelepot signalent à 9h15 que des éléments ennemis importants partent du village de Berny et utilisent les couverts (buissons et chemins creux) entre Horguy Berny et Fresnes, pour progresser vers le sud.
Un violent tir des chars de commandement et de la section réservée de chars R 35 stoppe cette progression vers 9h30, l'ennemi reprend sa progression sur le même axe avec des éléments de plus en plus importants. Ceux de tête arrivent à moins de 300 m du PC du bataillon.
La section réservée appuyée par les feux des deux chars B1 bis de commandement est lancée en contre-attaque sur ces éléments. L'attaque ennemie est brisée. La plupart des assaillants sont tués sur place, le reste soit : un officier, trois sous-officiers et 24 hommes de troupe sont faits prisonniers.
À 10h45 les chars suivis des chasseurs portés débarqués à Villers Carbonnel, arrivent à Pont les Brie, anéantissent toutes les résistances et organisent la défense du village et du pont. Le colonel commandant le G.R.D.I. signale à 11 heures qu'un important îlot de résistance ennemi (150 hommes environ) s'organise dans le parc du château de Misery et tire sur Marchelepot.
À 11h15, quelques groupes qui cherchent à déboucher du parc du château de Misery, sont immédiatement pris sous le feu des chars PC et de la section réservée.
Les chasseurs portés installés à Pont les Brie sont relevés à 11h30 par des éléments d'infanterie transportés par les tracteurs disponibles de la compagnie de chasseurs.
Vers 11h45 l'Officier de renseignements du bataillon (lieutenant Plattard) signale que d'importants éléments d'infanterie ennemis transportés par camions, s'installent à Berny et dans les boqueteaux à l'est.
La menace à l'ouest s'accentuant, une section de chars de la compagnie réservée à la disposition du colonel commandant la 2e demi-brigade est demandée d'urgence ainsi qu'un tir d'artillerie sur le village de Berny et les boqueteaux à l'est de ce village.
Le nord de Villers Carbonnel est encore très fortement tenu par l'ennemi.
Vers 13h15 une très violente contre-attaque d'engins blindés ennemis accompagnés d'infanterie, débouche de l'ouest de Villers Carbonnel et menace la colonne d'encerclement.
Cette contre-attaque est stoppée par le feu des chars PC et de la section réservée en position à 400 m sud de Villers Carbonnel. Simultanément d'importants détachements continuent à débarquer dans le village de Berny et les bois au sud-est. La demande d'une section supplémentaire de chars R 35 de la compagnie réservée est renouvelée ainsi que celle concernant les tirs d'artillerie.
L'artillerie ennemie prend à partie le PC du bataillon et la section réservée, mais les tirs sont mal réglés et les dégâts sont nuls. La défense du pont d'Epenancourt étant assurée par l'infanterie.
Les deux sections de chars sont repliées aux abords immédiats de Villers Carbonnel à 14h30.
Ce village très sérieusement bombardé depuis midi, est en flammes.
Vers 15 heures les engins blindés ennemis (six repérés) qui était parvenus à progresser au sud des bois de Berny et qui menaçaient d'encerclement la colonne sont dispersés et refoulés vers le nord par le tir de nos chars.
Le nettoyage par les chasseurs des derniers éléments ennemis retranchés dans les caves de Villers Carbonnel est terminé.
A 16 heures la colonne est reformée en direction du sud avec mission de nettoyer Fresne-Mazancourt qui a été réoccupé par l'ennemi, ainsi que le château de Misery point de résistance important d'où partent depuis le matin des groupes ennemis qui cherchent à s'infiltrer.
Cette double opération réussit parfaitement :
à 17h10 Fresne-Mazancourt est nettoyé. Le château de Misery est pris. Les éléments ennemis qui le défendaient, fuient vers l'est, sont tués sur place ou fait prisonniers. Un certain nombre de ces derniers qu'il n'a pas été possible de dénombrer sont remis au 22e R.I. régiment de marche qui prend possession du château, du parc et des bois.
La colonne est ensuite dirigée sur Marchelepot où les appareils font leur plein.
Pertes en personnel et en matériel :
2 blessés
2 chars R 35 détruits.
25 MAI 1940 : COMBATS DE LICOURT - EPENANCOURT
Le groupement tactique, renforcée de la 2e compagnie du 17e B.C.P. (capitaine Paoli) reçoit l'ordre de reprendre la tête de pont d'Epenancourt.
La colonne est reformée dans le même dispositif que la veille, sa tête à Marchelepot.
Elle débouche de Marchelepot à 1 heure, le village de Licourt est atteint à 2 heures. Un dispositif de sécurité (1ère compagnie de chasseurs portés (capitaine Paoli)) est installé au nord de Licourt. Les chars arrivent au pont d'Epenancourt à 2h45 suivis de la 1ère compagnie de chasseurs portés (capitaine Bouff). Le pont est pris et la défense est immédiatement mise en place.
Peu de réaction de l'ennemi.
À 4h15 aucune nouvelle de la compagnie d'infanterie qui doit relever les chasseurs à Epenancourt. Les chasseurs pris sous un très violent bombardement d'artillerie et de mortiers et sous le feu de nombreuses armes automatiques, sont forcés de se replier sur Licourt.
Le village est organisé défensivement avec l'appoint d'une partie de la 3e compagnie du 117e régiment d'infanterie amenée par le commandant Gillis de l'état-major de la D.C.R.
A 10h30 le bombardement de Licourt continue causant des pertes sévères, notamment à la compagnie Paoli.
L'ordre de repli des chars sur Etalon - Bois d'Herly arrive au PC à 11 heures.
Pertes en personnel et en matériel :
personnel : 1 tué, 4 blessés.
Matériel : Néant
V - PERIODE DU 26 MAI AU 4 JUIN 1940
Le bataillon regroupé à Etalon - Bois d'Erly a pour mission d'assurer la défense des bois entre Etalon et Herly, contre des attaques venant du Nord ou de l'est.
À 21 heures, le départ pour Villers les Roye (PC du bataillon et 349e compagnie, capitaine Marcille), l'Echelle Saint Aubin (351e compagnie, capitaine Colosiez), Audechy (2 chars de commandement).
L'arrivée du bataillon à Villers les Roye a lieu le 27 mai à trois heures :
mission : garde des issues, sûreté habituelle.
Le 28 mai : stationnement dans les localités ci-dessus, même mission.
Départ à 21 heures pour Quiry le Sec (PC et 347e compagnie) et Esclainvillers (349e compagnie) où le bataillon arrive le 29 mai à quatre heures. Il en repart trois heures plus tard pour Bonneuil les Eaux, où il arrive vers 11 heures.
Mission : se mettre en situation d'attaquer tout blindé ennemi qui déboucherait du Nord.
La compagnie 348 (capitaine Legraverand) qui stationnent au Bois de l'Hôpital est mise à la disposition du bataillon 8/15.
Elle se porte dans l'après-midi du 29 dans les bois au sud de Querbigny.
Le 29 mai à 19 heures, départ pour Grivesnes (PC et 348e compagnie), Ainval - Septoutre (347e), Esclainvilers (349e).
Arrivée le même jour vers 23 heures. Stationnement dans les localités ci-dessus toute la journée du 30.
Mission : s'opposer à des attaques éventuelles en direction du Nord. Garde des issues, sûreté habituelle.
Le 31 mai à 23h30, départ de Grivesnes pour :
Laboissière : (PC et 348e compagnie)
Lignières : (347e compagnie)
Becquigny : (349e compagnie)
1er juin, stationnement dans les localités ci-dessus.
Mission habituelle.
À 21 heures, départ pour les bois à l'ouest de Taisnil.
Arrivée le 2 juin à trois heures. La journée du 2 est employée à la visite des appareils et de l'armement, au graissage et aux pleins.
2 juin à 20h45, départ pour les bois de la Cavette (nord de la Neslette). Arrivée à 23 heures.
3 juin, stationnement. Reconnaissances de terrain pays d'itinéraires par les cadres. Préparation du matériel, réglage des postes, ajustage des réseaux. Vérification des armes et des appareils de pointage.
Le lieutenant Dupont rejoint le bataillon vers 16 heures avec 6 chars B1 bis, provenant des ateliers de l'échelon.
Le bataillon quitte les bois de la Cavette à 21h30 et se porte sur ses positions de départ.
Point de première destination : Grébault - Mesnil où les pleins sont effectués entre le 23 heures et 24 heures.
VI - ATTAQUE DE LA TETE DE PONT D'ABBEVILLE (4 juin 1940)
Le bataillon est constitué à trois compagnies de chars B1 et B1 bis
Compagnies chars provenant de l'unité ci-dessous :
1ère Compagnie commandée par le lieutenant Dupont du 8e B.C.C.
348e Compagnie commandée par le capitaine Fissiaux
349e Compagnie commandée par le capitaine Marcille
1 char de commandement MARSEILLE n° 234
DISPOSITIF :
1er échelon - à droite : la 348e compagnie Fissiaux, opère dans la zone est du ravin de Boencourt entre la route d'Abbeville à Rouen et le ravin.
à gauche : la compagnie Dupont, opère dans la zone boisée ouest du même ravin à travers le village de Bienfay et de Mesnil Trois Foetus.
2e échelon - la 349e compagnie Marcille, progresse à travers la zone est, dans les traces de la 348e compagnie.
Les compagnies atteignent leur positions de départ le 4 juin à trois heures :
Compagnie Dupont avec 7 chars,
Compagnie Fissiaux avec 7 chars,
Compagnie Marcille avec 6 chars,
et le char de commandement, soit 21 chars au total.
Elles débouchent à 3h20. Un brouillard intense amène des chars de la compagnie Dupont à dévier de leur axe de marche.
Ils partent en direction du nord-est.
Les trois compagnies franchissent peu après l'heure H (3h30) la ligne tenue par l'infanterie écossaise (152e brigade).
Les unités du premier échelon atteignent et dépassent vers 4h30 le premier objectif (O1) jalonné par :
Mesnil Trois Fœtus - Mont de Caubert.
À huit heures, les compagnies Bouff et Paoli du 17e B.C.P. progressent en direction de O1 avec une extrême difficulté.
La C.E. du capitaine Rebuffel du 17e B.C.P. progresse au fond du ravin de Boencourt est atteint le carrefour ouest du Mont de Caubert au nord du bois de Villers.
La compagnie Gelot du 17e B.C.P. atteint et occupe les lisières sud des vergers de Mesnil Trois Foetus.
Un des chars de la compagnie Dupont qui avait atteint la route nationale d'Abbeville rejoint sa compagnie vers six heures dans le ravin de Boencourt au sud-est de Mesnil Trois Foetus après avoir aidé la compagnie Rebuffel du 17e B.C.P. a progresser dans ce ravin où elle était bloquée par des feux provenant des lisières nord-ouest du bois de Villers et des crêtes nord du ravin.
Quatre chars seulement, 2 de la compagnie de droite de premier échelon (Fissiaux) et 2 de la compagnie de gauche (Dupont) atteignent et dépassent vers six heures le second objectif O2 jalonné par :
la crête militaire du Camp de César et la croupe à l'est de Yonval.
La compagnie Fissiaux perd 4 chars sur les mines entre la ligne ennemie et le premier objectif dans le goulot entre le bois de Villers et la route nationale à la naissance du ravin est ouest, 500 m au nord de Mareuil Caubert.
Ce ravin est fortement tenu par des antichars.
Les compagnies Bouff et Paoli du 17e B.C.P. s'installent vers 7h50 à proximité de cette ligne et de la côte 104, sur la route nationale.
La compagnie Dupont qui progresse sur la pente est du ravin central perd 4 chars par antichars de gros calibre, en batterie à la lisière ouest du bois de Villers et sur les pentes nord du ravin à hauteur de Mesnil Trois Fœtus et du Camp de César.
La compagnie Gelot du 17e B.C.P. atteint Mesnil Trois Fœtus vers 9h30, appuyée à droite par les Écossais.
La compagnie Marcille qui suit la compagnie Fissiaux en deuxième échelon peut éviter les champs de mines en les contournant par l'est vers la route d'Abbeville, mais elle perd 2 chars par antichars de gros calibre en batterie dans le ravin nord de Mareuil.
Les 6 chars B restants, progressent dès lors sans grande difficulté, dépassent le second objectif et nettoient les pentes nord-est de l'éperon du Camp de César, à l'est et les ravins transversaux de Yonval à l'ouest.
Les chars de droite sont néanmoins soumis à de violents tirs d'artillerie provenant de la rive droite de la Somme.
L'infanterie écossaise, par contre, ne peut déboucher, les bois de Villers étant encore tenus dans leur partie nord par plusieurs des armes antichars et automatiques.
D'autres armes antichars et automatiques ennemies viennent s'installer (ou se démasquent) sur la route nationale, à hauteur du ravin 500 m nord de Mareuil Caubert, leur feu ralentit la progression des chars d'accompagnement (dont plusieurs sautent sur des mines) et stoppent l'infanterie écossaise à droite.
Des groupes ennemis traversent le plateau du Mont Caubert et viennent installer sur les lisières est du bois de Villers des armes antichars et automatiques qui en renforcent la défense.
À partir de neuf heures les lisières sud de du bois de Villers, le ravin à l'est de Bienfay et les vergers sud de Mesnil Trois Fœtus sont violemment pris à partie par l'artillerie et l'aviation ennemie qui bombarde en piqué.
Les chasseurs des compagnies Bouff et Paoli déployés sur la parallèle Bienfay - Côte 104, sont également bombardés en piqué et mitraillés.
Non suivis par l'infanterie et les chars d'accompagnement, les deux chars B de la compagnie Fissiaux gagnent la lisière sud-est du bois de Villers tandis que les deux chars B de la compagnie Dupont se défilent dans le ravin à 200 m est de Bienfay, sur la route de Mareuil. Au cours de ces mouvements, l'un des 2 chars de la compagnie Marcille qui regagne également le bois de Villers est immobilisé à proximité de la lisière du nord-est du bois de Villers par une quinzaine de coups d'antichars.
Un char B de la compagnie Dupont saute sur une mine à 150 m des vergers sud de Mesnil Trois Foetus, après avoir détruit 6 antichars en action dans ces vergers. Son équipage reste en char jusqu'à 22 heures en tenant sous le feu de son canon de 47 et de ses mitrailleuses, l'infanterie ennemie qui ne peut déboucher des vergers.
Les éléments de combat sont ralliés aux lisières sud du bois de Villers vers neuf heures. Un char de la compagnie Fissiaux resté en panne avant la P.D. rejoint la P.R. par ses propres moyens.
Tous les éléments quittent le bois de Villers vers 18 heures et sont rassemblés dans les bois à l'est de Grébault-Mesnil.
Le bataillon arrive au bois de La Cavette entre 23 heures et 24 heures.
Pertes.
Personnel :
Tués : 1 aspirant, 2 hommes de troupe
Disparus : 2 officiers, 1 sous-officier, 6 hommes de troupe.
Matériel :
| Compagnie | Quittent la P.D | Détruits par | regagnent la P.R. | |||
| antichars | mines | panne de terrain | incendie | |||
| Fissiaux | 7 | 1 | 4 | 2 | ||
| Dupont | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Marcille | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Commandement | 1 | 1 | ||||
| Total : | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 |
5 juin 1940 - le bataillon quitte Neslette pour Sommereux vers 16 heures. Un char B en panne à Marseille en Beauvaisis est remorqué par l'élément avancé d'atelier.
Arrivée à Sommereux vers 23h30.
VII - PERIODE DU 6 AU 9 JUIN 1940
Le 6 juin, stationnement à Sommereux, même mission, garde des issues - sûreté habituelle.
Dans l'après-midi, un groupe de six chars Somua et de cinq chars Hotchkiss commandé par le capitaine Leger du 7e cuirassiers, vient renforcer le bataillon.
Deux reconnaissances (chars B et chars légers) sont effectuées sur Poix, l'une dans la route nationale Grandvilliers - Poix, l'autre par Thieulloy - Saulchon - Poix.
Ces reconnaissances identifient une Panzerdivision bivouaquée dans les bois ouest de Poix. Une section de canons de 47, protégée par trois chars B est mis en batterie sur la croupe sud du village.
La journée se passe sans incident notable.
Le 7 juin, à 20 heures le bataillon reçoit l'ordre de se replier sur Auchy la Montagne.
Une patrouille de trois chars (1 Somua, 2 Hotchkiss) est envoyée au carrefour Le Hamel, route Grandvilliers - Crèvecoeur pour protéger vers l'ouest le repli du 17e Bataillon de Chasseurs Portés pendant que les autres chars en position au sud du village de Sommereux assurent le décrochage de la colonne.
Le bataillon arrive à Auchy la Montagne vers 23h30.
Le 8 juin, une reconnaissance de trois chars (1 Somua, 2 Hotchkiss) est poussée vers la route Crèvecoeur à Francastel où avait été signalée la présence d'engins blindés ennemis.
Le bataillon quitte Auchy la Montagne à 20h30, lorsque la sortie sud du village les éléments de tête (chars et véhicules du PC) sont accrochés par des automitrailleuses et des chars ennemis.
Automitrailleuses et chars sont détruits, mais le convoi sur roues (véhicules du PC du bataillon) pris sous le feu, perd :
Un tué, deux blessés graves et cinq blessés légers.
La voiture médicale et les deux voitures de liaison du bataillon sont criblées de balles.
VIII - PERIODE DU 10 AU 25 JUIN 1940
Le bataillon quitte Fronville à 10 heures le 10 juin, franchit l'Oise à 12 heures et arrive vers 15 heures à Mériel où il reçoit la mission d'organiser la défense des ponts de Mériel et de Mery, en liaison avec le 27e B.C.C. et le 17e B.C.P.
Même stationnement et même mission.
Le 11 juin, les services du Génie font sauter les ponts entre 19 et 20 heures et le bataillon se porte sur Bièvres, en contournant Paris par l'ouest.
Un char Somua en panne au Petit Clamart, qui n'a pu être ni réparé, ni remorqué, est détruit.
Le 12 juin, arrivée à Bièvres vers cinq heures. Stationnement, puis départ pour Montmirault à 16 heures.
Un char Somua en panne à Verrières, n'a pu être ni réparé, ni remorqué. Il est détruit.
Le 13 juin, stationnement à Montmirault. Départ pour Janville à 13 heures, arrivée à Janville à 23 heures.
Mission : assurer la garde des issues.
Un Somua et un Hotchkiss en panne entre La Ferté Allais et Etampes n'ont pu être ni réparés, ni remorqués. Ils sont détruits.
Stationnement à Janville le 15 juin, même mission, départ à 21 heures et arrivée à Bazoches les Gallerandes à 23h30.
Même mission qu'à Janville, sûreté habituelle.
Stationnement à Bazoches les Gallerandes.
Le 16 juin : départ pour Gruy à 20 heures, le bataillon étant en arrière garde de la colonne est de la D.C.R.
Vers 22 heures, la tête de colonne du bataillon se heurte à un barrage ennemi de flanc garde, à ……. (Antichars et armes automatiques). L'itinéraire est détourné vers l'ouest, la colonne franchie la Loire au Pont de Mer, le 17 juin à 10 heures et atteint Gruy à 13 heures.
Départ de Gruy pour Cerbois le 18 juin à quatre heures, passage du Cher à La Chatre, et arrivée à Cerbois (Cher) à 16 heures. Stationnement et bivouac. Mission : défense des bois à l'est de Cerbois.
18 juin : même stationnement, bivouac et même mission que la veille.
Départ de Cerbois le 19 juin à 22h30. Un char Hotchkiss en panne mécanique a été détruit.
Arrivée à Lys Saint Georges le 20 juin à 7h30. Un char Hotchkiss et un char Somua en panne mécanique grave sont détruits.
Départ de Lys Saint Georges (Indre) le même jour à 20h45.
Arrivée à Villard le 21 juin à trois heures.
Départ de Villard le 22 juin à 21 heures.
Arrivée à Chauverne-Neyre le 23 juin à cinq heures. Stationnement, bivouac à Chauverne-Neyre.
Le 22 juin : stationnement, bivouac à Chauverne-Neyre.
Le 25 juin : stationnement, bivouac à Chauverne-Neyre.
ARMISTICE
Le bataillon est dissous le 8 juillet 1940 à Bourganeuf (Creuse) par le commandant de la 2e D.C.R. par ordre n° 4475/3.
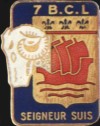 |
RELATION DÉTAILLÉE
DU COMBAT DE LA 3e COMPAGNIE DU 7e BATAILLON DE CHARS LÉGERS
|
par David Lehmann
Le 13 mai 1940 à 17 heures, le 7e B.C.L. en position d'attente depuis trois jours aux ALLEUX (près du CHENE POPULEUX en Argonne) recevait l'ordre de ne porter dans les bois sud de SEDAN en vue "éventuellement", de contre-attaquer si l'ennemi réussissait à franchir LA MEUSE. Ce que ne disait pas l'ordre c'est que cette éventualité était un fait accompli depuis quelques heures.
Le mouvement des chars a commencé dès la tombée de la nuit en utilisant la route nationale VOUZIERS-SEDAN, seul itinéraire possible. Les compagnies sont mises en route dans l'ordre 1-2-3. Cette progression dans la nuit, qui aurait du demander trois heures au maximum se prolongea jusqu'au lendemain matin 6 heures. Une panique effroyable, à la nouvelle que les Allemands avaient franchi LA MEUSE avait jeté pêle-mêle sur les chemins, populations civiles, équipages militaires désemparés, convois, etc ..... Toute cette cohue se repliait sur VOUZIERS en encombrant la route d'un triple et même quadruple courant. Tandis que les chars légers du 7e B.C.L. se frayaient péniblement un passage vers le nord.
A 5 heures du matin, la 3e Compagnie est en entier au Bois du Mont Dieu :(13 chars et un élément avancé de son échelon sur roues). Elle est loin d'avoir atteint son point de destination (il est vrai que les Boches y sont depuis la veille), les équipages sont exténuée par 8 heures d'un pénible pilotage nocturne. La route s'est un peu dégagée mais il fait jour et les avions ennemie commencent leur ronde. Déjà le camouflage est entrepris quand le capitaine MIGNOTTE commandant la compagnie reçoit l'ordre de se mettre à la disposition de la 55e division d'infanterie pour contre-attaquer en direction de SEDAN dès le lever du jour. Le rendez-vous fixé est CHÉMERY (6 km plus au Nord) avant 4 heures du matin. Il est 4 heures 45 !
Plus personne ne songe à la fatigue. Les hommes comme les gradés sont furieux du retard qu'ils ont du subir. Le combat est engagé sans eux ! Ils ont raté leur baptême du feu ! Du moins ils le croient.
Tandis que le commandant de compagnie fonce en moto à CHEMERY au P.C. de la division, le lieutenant adjoint (lieutenant HERAUD reforme la colonne de chars et reprend la route. On se moque bien du camouflage anti-aérien, il faut arriver. Malheur à la "401 Peugeot" d'un artilleur endimanché, elle refuse d'appuyer à droite pour ne pas égratigner sa belle carrosserie aux ronces qui débordent. La colonne de chars est passée …… la "401" n'a plus d'aile gauche et son conducteur vocifère au milieu de la route.
A CHEMERY la division est déjà partie et c'est un officier envoyé par le commandant GIORDANI (commandant du 7e B.C.L.) qui met le commandant de la 3e compagnie au courant de sa mission. Elle est à la fois simple et tragique et peut s'exprimer ainsi :
"La situation empire d'heure en heure. Les Boches ont franchi la MEUSE avec "quelques" éléments transportés sur camions et autos. Il faut barrer la route SEDAN-VOUZIERS, la nettoyer de tout ennemi et si possible pousser jusqu'à SEDAN. A tout le moins résister sur place jusqu'à l'arrivée de renforts qu'on ne doit pas espérer avant ce soir. Il reste très peu d'infanterie, aucune artillerie et aucune aviation pour aider l'action des chars qui ne devront compter que sur eux. La 3e Compagnie agira seule pour barrer l'axe routier SEDAN-VOUZIERS et la vallée de LA BAR. Le succès réside à sa rapidité d'intervention. Les deux autres compagnies du bataillon seront à 3 km plus à l'est pour tenir les débouchés des bois.
La colonne de chars n'étant pas encore arrivée, le commandant de compagnie en profite pour reconnaître le terrain d'action et voir sur quelle infanterie il peut compter. Il s'engage, toujours en moto, la route de SEDAN. Quelques fantassins sont à la sortie Nord de CHEMERY avec un chef de bataillon et un sous-lieutenant. Ne pouvant croire que ce soit là la seule infanterie destinée à la défense de la vallée le capitaine de chars poursuit sa route vers le nord à la recherche de son infanterie. Près de 2 km sont parcourus sans rencontrer âme qui vive. Le silence devient inquiétant. Revenant à CHEMERY le capitaine de chars y retrouve le chef de bataillon d'infanterie qui l'informe que c'est bien son bataillon qui doit progresser "en marche d'approche" vers SEDAN. Il ajoute qu'il dispose en tout à peine de l'effectif d'une compagnie. Contemplant la poignée d'hommes, l'officier de chars n'est pas bien sûr qu'il ne se vante.
Les fantassins qui sont là sont exténués. Ils ont du se replier dans la nuit en proie aux sinistres rumeurs que répand "une cinquième colonne" très active et dont on ne se méfie pas encore suffisamment. Deux jours de bombardements aériens ont brisé les nerfs de ces hommes qui n'avaient jamais vu le feu. Il n'y a que deux chargeurs par F.M., pas une grenade, un seul canon de 25mm servi par des coloniaux venus d'une compagnie divisionnaire.
Tout ceci n'impressionne nullement le capitaine de chars qui a confiance dans son matériel : 13 chars F.C.M. de 12 tonnes. Le carburant gasoil garantit encore 12 heures de marche malgré les 8 heures de la nuit précédente. La dotation en munitions est complète. Beaucoup d'obus explosifs mais 12 obus de rupture seulement. Qu'importe, ces obus sont inutiles puisque aucun blindé n'est signalé comme ayant passé la MEUSE.
Un coup d'œil sur la carte indique un étranglement de la vallée à 1200 mètres au nord de CHEMERY. A cet endroit la rivière LA BAR borde la route et constitue un obstacle presque absolu dans la partie ouest de la vallée. Sur son rebord est la route est dominée par un talus boisé qui se soude à la hauteur du bois de NAUMAY ; sur ce flanc de la vallée il ne saurait y avoir que des infiltrations d'éléments à pied. L'intention du chef des chars est d'atteindre ce point favorable le plus vite possible pour ne pas être tourné. Ensuite on verra.
La colonne de chars dirigée par le lieutenant HERAUD en tête dans le char de commandement, arrive à 6 heures 10 à la sortie nord de CHEMERY. Les minutes sont précieuses, impossible de donner des ordres détaillés, il faut gagner l'ennemi de vitesse. Une seule tactique possible : le capitaine, dans son char, fera manœuvrer la compagnie au fanion. La section de tête est celle du sous-lieutenant PAGES ; elle demeurera en tête et progressera sur l'axe de la route, le lieutenant HERAUD préviendra au passage les autres chefs de section de se conformer à l'attitude du capitaine
La compagnie s'ébranle, la char PAGES sur la route, le char du capitaine ayant déboîté sur la gauche est entre LA BAR et la route. Les autres sections sont encore dans CHEMERY mais déjà ramassées et prêtes à s'élancer. Quelques fantassins sont tapis au bord de la route et dans les broussailles qui bordent la rivière ; la présence des chars les rassure un peu, mais ils sentent leur faiblesse numérique et n'ont pas l'air d'avoir grande envie de progresser. Les chars ont parcouru quelques centaines de mètres quand éclate le premier coup de canon. C'est une pièce anti-char boche dissimulée sur le rebord est de la route qui vient de se dévoiler et ouvre le feu sur le char de PAGES (cette pièce ne s'était pas révélée quand le capitaine était passé à côté au cours de sa reconnaissance en moto une demi-heure plus tôt). Instant de surprise et d'émoi. Tous les chars s'arrêtent : c'est le baptême du feu terrestre !
Mais ce flottement ne dure pas. Tandis que la section PAGES riposte sur l'engin ennemi, le capitaine s'élance dans la prairie en ordonnant en bataille avec son fanion. La section du sous-lieutenant LACROIX voit le signal et s'engage sur les traces du char de commandement, mais la section de l'aspirant LOISEAU n'a pas vu le petit fanion blanc et vert. Elle reste sur la route derrière la section PAGES empêchant le débouché de la section du sous-lieutenant LEVITTE. Le commandant de compagnie revient en arrière et se plaçant près des sections LEVITTE et LOISEAU il recommence le signal en bataille. Le lieutenant LEVITTE se rendant compte de l'appel qui lui adresse son commandent de compagnie bondit littéralement avec son char qui vient se placer à côté le celui du capitaine et entre en liaison à voix. La section LOISEAU procède par imitation et quand le char de commandement reprend la tête il est suivi par la compagnie déployée. Le char de PAGES n'a pas cessé de subir le feu de l'ennemi pendant cette manœuvre. Un obus lui a brisé une chenille et toute cette section est bloquée sur la route.
A ce moment une deuxième pièce anti-char se révèle un peu plus loin dans le fossé de la route. Mais cette fois la compagnie de chars est lancée et les deux engins ennemis sont détruits en très peu de temps par la concentration de feux des chars. Beaucoup de coups ont frappé le blindage des "F.C.M.", aucun n'a perforé. Les équipages prennent conscience de leur puissance et c'est la ruée vers le goulet. Quelques éléments ennemis ont été aperçus, ils sont massacrés ou disparaissent dans les carrières et dans les bois. L'étranglement de la vallée est atteint.
Avant de poursuivre plus loin, il faudrait quelques éléments d'infanterie pour tenir ce passage. Or l'infanterie est restée à CHEMERY, se contentant d'accompagner les chars de ses vœux !
Manœuvrant au fanion, la compagnie revient en arrière pour reprendre le contact. Vieille réminiscence de l'Ecole des chars : "L'infanterie ne suit pas. Que fait-on ?"
Assis sur sa porte de tourelle, pour bien montrer que tout danger était écarté, le capitaine exhorte quelques fantassins à le suivre et c'est ainsi que les chars repartent en avant en ramenant une dizaine d'hommes. Sitôt le goulet dépassé on aperçoit à 600 mètres, dans le fond de la vallée, le village de CONNAGE un peu à l'ouest de la route nationale.
Tout le terrain entre CHEMERY et le goulet étant déblayé le capitaine engage son char au-delà de l'étranglement et se porte sur CONNAGE suivi des sections LOISEAU et LACROIX. La section LEVITTE qui longeait le cours de LA BAR s'est embourbée dans un marigot. La section PAGES dont le char de tête n'a pu être encore réparé est toujours immobilisée sur la route un peu au Nord de CHEMERY.
Le mouvement sur CONNAGE s'exécute sans incident. Le village et ses abords sud ont été évacués par les Allemands. Toujours commandés au fanion les chars reviennent en arrière du goulet ; au cours de ce déplacement ils reçoivent quelques obus lancés par une batterie anti-char qui vient de s'installer sur la hauteur à l'est de CONNAGE. Un de ces projectiles a mis le feu à la bâche du char du sergent LE TALLEC ; cette bâche, pliée, était arrimée sur le côté du blindage, la rapidité d'intervention n'ayant pas permis de la retirer avant le combat. Dans l'ardeur de la lutte l'équipage ne s'est aperçu de rien et le feu risque de se communiquer au réservoir de gasoil. Le capitaine descendant de son appareil se porte vers le char en danger réussit à décrocher la bâche enflammée.
Aucun coup de feu ne retentit, ce que voyant le sous-lieutenant LACROIX sort du char à son tour et vient prendre les ordres de son chef pour la suite de l'affaire.
A ce moment six chars sont réunis aux abords de l'embranchement de route dans un angle mort qui lui permet d'échapper aux vues et aux coups de la batterie anti-char. Celui du sous-lieutenant LACROIX et ses deux chars subordonnés (sergent CORBEIL, et caporal-chef TIRACHE), deux chars de la section LOISEAU (celui du sergent LE TALLEC et celui du sergent BOITARD), enfin le char du capitaine. Le char de l'aspirant LOISEAU s'est embourbé dans un marigot aux abords de CONNAGE.
La section LEVITTE essaye de se dépanner et malgré le tir la batterie anti-char, on voit le lieutenant, à pied, dirigeant la manœuvre pour tenter de sortir du marigot le dernier char qui s'y trouve encore.
Les ordres donnés par le commandant de compagnie sont les suivants :
"La section LACROIX progressera en tête sur l'axe de la route.
Ligne à atteindre :
1. la route CONNAGE - BULSON,
2. les lisières de CHEHERY.
"Le capitaine se placera au centre du dispositif au mieux des circonstances. Se tenir prêt à obéir au fanion du commandant de compagnie.
"La section LEVITTE ne pouvant être atteinte par les ordres sera considérée comme momentanément en réserve. Le commandant de Compagnie est sur que le lieutenant LEVITTE dont l'ardeur est proverbiale le rejoindra dès que ce lui sera possible."
Tout ceci a demandé cinq minutes à peine et déjà LACROIX a bondi dans son char et démarre. Il vient de s'ébranler quand au détour de la route, à une centaine de mètres à peine, un char boche apparaît et s'immobilise. C'est un engin de 30 à 40 tonnes qui encombre la plus grande partie de la route. Le sous-lieutenant LACROIX se précipite littéralement sur lui, s'arrête à 15 mètres et commence un feu nourri. Il a été suivi instantanément par un de ses chars (celui du sergent CORBEIL) et par celui du sergent LE TALLEC
La capitaine est encore à pied en dehors de son char, il arrête les deux autres appareils qui commençaient à s'ébranler et donne au sergent BOITARD et au caporal-chef TIRACHE qui les commandent, l'ordre de rester en arrière à 300 mètres environ pour appuyer de leurs feux les chars de tête. Puis il monte dans son appareil et va se placer à côté du char de LACROIX.
Le combat chars contre chars commence. Mais la lutte est inégale. De notre côté six chars légers de 12 tonnes armés chacun d'une mitrailleuse et d'un canon de 37 modèle 1916, c'est-à-dire un canon inapte à la lutte contre blindés.
Du côté allemand trois chars de 35 tonnes à 15 ou 20 mètres en face de nos quatre appareils de tête ; un peu en arrière sur la route, sur la hauteur et dans le fond de la vallée, une nuée d'autres chars ennemis.
L'approvisionnement en obus de rupture (12 obus par char) est bientôt épuisé. Le tir continue à obus explosifs. Ceux-ci aveuglent les chars allemands qui ne ripostent qu'avec une extrême lenteur. Beaucoup de leur obus ricochent sur nos blindages, mais ceux d'entre eux qui arrivent de plein fouet les traversent. C'est ainsi que le mécanicien LINTANFF est grièvement blessé. Un peu plus tard c'est le tour du sous-lieutenant LACROIX. Touché à la poitrine il jaillit ensanglanté de son char et s'effondre inanimé dans le fossé de la route. Son mécanicien le chasseur ROCHELLE prend sa place dans la tourelle, car le feu de ce char recommence presque aussitôt. Un peu plus tard, c'est le silence : ROCHELLE, sans doute touché à son tour, n'a plus été revu.
Le combat se prolonge. Un char allemand est en flammes. C'est alors que l'ennemi met en oeuvre un canon plus important (calibre 75 et même 105 pour certains chars) placé dans l'axe de chaque appareil. Ces projectiles tirés à bout portant sont extrêmement meurtriers. C'est d'abord le char de CORBEIL qui est éventré à l'avant ; le mécanicien LINTANFF qui, un obus de 37 logé à la base du cou continuait de passer les munitions à son chef de char, a le ventre ouvert. Imperturbable, CORBEIL continue à tirer. Un second coup lui détériore son arme. Il sort alors de son char et s'abrite tant bien que mal dans le fossé de la route.
Le char du sergent LE TALLEC reçoit un obus dans la chambre du moteur et s'enflamme. Pendant plusieurs minutes l'équipage continue à tirer, puis la chaleur devant intenable, à son tour il est obligé d'évacuer. Le sergent et son mécanicien (le chasseur AUDOIRE) s'échappent au plus fort de la bagarre et courant vers les buissons qui bordent LA BAR, ils regagnent CHEMERY où ils sont recueillis par le lieutenant HERAUD qui de loin, assiste au combat.
Des quatre chars de tête, seul celui du commandement est encore en état de tirer. Deux obus de rupture ont pénétré dans la tourelle, mais par miracle l'équipage est indemne. Le capitaine prescrit à son mécanicien de faire demi-tour sur place, de manière à avoir une plus grande protection en se couvrant de toute l'épaisseur du moteur. Le canon dirigé vers l'arrière continue à tirer. Le demi-tour vient à peine d'être achevé qu'un gros obus (sans doute du 105) arrache la chenille gauche et déplace le char de plusieurs mètres. Se rendant compte qu'il ne pourra tenir longtemps le commandant de compagnie ordonne à son mécanicien (chasseur HEINRICH) d'évacuer en profitant d'un feu nourri qu'il déclenchera pour aveugler l'ennemi. Le chasseur HEINRICH devra prévenir au passage les deux chars arrière (sergent BOITARD et caporal-chef TIRACHE) de se replier sur CHEMERY pour se mettre aux ordres du lieutenant HERAUD. D'ailleurs le char de BOITARD est momentanément hors de combat, son chef ayant été intoxiqué par les gaz provenant du tir de la mitrailleuse. Quant à celui de TIRACHE il ne se déplace que péniblement un galet de son train de roulement ayant été arraché par un obus anti-char. Le char du capitaine après un tir répété et violent se tait ; l'arme est enrayée. Les Allemands croyant tout fini cessent le tir et pendant de longues minutes c'est le silence de part et d'autre. La culasse du canon du capitaine est débloquée, l'arme est de nouveau prête à tirer. Il reste une trentaine d'obus.
Enfin un char boche s'ébranle et fait quelques mètres lentement. Le char français reprend son tir et l'ennemi s'immobilise. La pétarade reprend. le char de LE TALLEC qui continue à brûler protège en partie par sa masse celui du capitaine. Les Allemands dont les chars marchent à l'essence n'osent pas en approcher pour prendre dans l'axe de leur gros canon le dernier char français et seuls les obus de rupture lancés des tourelles crépitent sur le blindage du char léger.
Les derniers obus du char de commandement sont épuisés. Jusqu'à CHEMERY le terrain est vide d'amis. Tous les autres survivants semblent avoir réussi à rejoindre. Le commandant de compagnie sort de son char par la porte avant sans aucune précaution : il est exténué et s'attend à tout. Surprise ! les chars allemands cessent le feu. Le sergent CORBEIL qui était toujours dissimulé derrière son talus court vers son chef, l'aide à se relever et l'entraîne vers la hauteur, vers les bois. Une heure plus tard ils arrivaient à CHEMERY où le lieutenant HERAUD et le lieutenant CHASSEDIEU, chef de la section d'échelon les accueillent.
Ces deux officiers ont déployé une activité fructueuse pendant toute la matinée. Tandis que CHASSEDIEU se porte lui-même avec deux dépanneurs auprès des chars de PAGES pour tenter de les réparer, le lieutenant HERAUD avec d'autres dépanneurs et quelques motocyclistes faisant le coup de feu contre des éléments ennemis qui ont progressé par la rive Ouest de LA BAR (Zone de l'Armée voisine) les empêche de s'emparer des lisières de CHEMERY. Grâce à leur action trois chars seront récupérés et les équipages qui ont pu sortir des appareils détruits rentrent dans nos lignes.
La 1ère et la 2e Compagnie du 7e B.C.L. qui avaient reçu une mission à peu près analogue un peu plus à l'Est dans la Région BULSON-MAISONCELLE avaient connu le même destin. Elles avaient bloqué l'avance ennemie mais étaient aux trois-quarts détruites.
L'ennemi ne pouvant croire que ces chars légers, qui les ont tenus en haleine toute la matinée, sont seuls dans ce secteur, n'ose pas poursuivre avant de s'être réorganisé. Il occupe le reste de la journée à rassembler des forces nouvelles pour prononcer une attaque en force. Mais le soir du 14 mai vers 18 heures la 3e Division Cuirassée et les premiers éléments de la 3e Division d'Infanterie Motorisée arrivent au MONT DIEU où ils libèrent définitivement ce qui reste de chars. Quand l'attaque se déclenche le 15, la défense est solidement organisée et les Allemands subissent de lourdes pertes. La route de VOUZIERS est bien barrée.
C'est au bois du MONT DIEU, là où l'ordre de s'engager avait touché la Compagnie que les survivants se regroupent. Il manque :
· 4 chefs de section,
· 3 chefs de char,
· 7 mécaniciens,
soit 14 hommes sur les 26 qui composaient les équipages.
La magnifique résistance des chars a enthousiasmé le commandement. La radio officielle célèbre cet exploit et tous les journaux de France le relatent dans les termes suivants :
L'HEROISME D'UN BATAILLON DE CHARS LEGERS FRANÇAIS
PARIS - 25 mai .- La bataille qui se poursuit dans le Nord est faite d'innombrables traits de dévouement et de courage de nos officiers et de nos soldats de toutes armes.
Les 13 et 14 mai, à l'un des moments les plus critiques la lutte, quand notre infanterie, malgré tout son acharnement, semblait devoir succomber sous la masse des avions et des engins blindés de l'ennemi, un bataillon de chars légers français joua un rôle capital. La moitié des effectifs de ce bataillon, les trois quarts de ses chars sont restés sur le terrain. C'est grâce à l'esprit de sacrifice de chacun que la mission a été remplie.
Comment choisir entre tant d'actes d'héroïsme ? .....
Le capitaine M…… son char en panne, continue à tirer pour couvrir le repli de son mécanicien. Quand ses munitions sont épuisées, il dirige le retrait de ses chars dans un ordre parfait freinant puissamment l'avance ennemie.
Pendant un engagement contre les chars lourds allemands, le lieutenant L…… part à l'assaut en flèche ; son char touché prend feu. On aperçoit L…… au moment où il arrache son mécanicien aux flammes avant de tomber mortellement blessé.
Et voici peut-être l'épisode le plus étonnant de cette épopée d'un coin du champ de bataille.
Le sous-lieutenant L…… à la fin d'une contre-attaque acharnée, voit plusieurs de ses chars touchés par des obus de fort calibre, immobilisés ; le sien, en particulier, était traversé de part en part par un projectile. Ses camarades furent tués et il fut porté disparu.
Le lendemain, à midi, à la popote, alors que chacun évoquait le souvenir de ce brave officier, ses camarades le virent, avec stupeur, apparaître. Son manteau de cuir déchiré, couvert de boue, il avait l'air d'un revenant de l'autre monde, et chacun se précipitait pour connaître son aventure.
Quand son char fut percé, par un projectile de gros calibre, il sortit, sous le feu, emportant dans ses bras son mécanicien qui avait le ventre ouvert et le bras droit cassé.
En cours de route, il ramena avec lui trois autres de ses mécaniciens et, comme le petit groupe cherchait à rejoindre nos lignes, il tomba soudain au milieu d'un parc allemand.
C'est alors que les quatre soldats valides et le blessé se cachèrent dans une rivière, entrant dans l'eau profondément et se dissimulant sous les racines d'un saule. Chaque fois que les boches passaient, nos Français plongeaient la tête dans la rivière.
"Nous avons attendu ainsi une heure" dit le sous-lieutenant L……
"Nous les entendions; ils parlaient, fumaient et gibernaient tout autour de nous.
".... Si nous avions eu un fusil-mitrailleur, nous les descendions, mais nous n'en avions pas. Nous avions le blessé avec nous. Il commençait à râler entre mes bras ; j'ai vu ses yeux ne révulser ; j'ai compris qu'il était mort ; je l'ai lâché et l'ai laissé partir au fil de l'eau.
Noue sommes resté là jusqu'au soir. A la nuit, nous sommes sortis de la rivière, cherchant à rejoindre nos lignes à travers le parc des "Fritz". Ce ne fut que le matin, au petit jour, que j'ai pu rejoindre nos lignes et que nous fûmes recueillis par des camarades ".
On imagine la joie, l'émotion, avec laquelle les camarades sous-lieutenant rayèrent son nom et ceux des trois mécaniciens de la liste des disparus.
La 3e Compagnie est généreusement récompensée par le général HUNTZINGER commandant la IIe Armée. Une proposition de citation collective à l'ordre de l'Armée est transmise dans ces termes au G.Q.G. :
3e COMPAGNIE DU 7e B.C.L.
"Unité ardente et manœuvrière qui, sous le valeureux commandement de son chef, a réalisé à tous les échelons un splendide acte de bravoure en s'opposant efficacement le 14 mai dans la région CHEMERY, CHEHERY, BULSON, à la progression d'une unité blindée ennemie d'une puissance offensive et défensive supérieure. Mérite, comme l'A.S. 321 dont elle a brillamment continué les traditions, la citation à l'ordre de l'Armée et l'attribution de la Croix de Guerre.
En outre, les récompenses individuelles suivantes sont décernées :
· 4 croix de Chevalier de la Légion d'Honneur
· 3 médailles militaires
· 21 croix de guerre dont 6 avec palme.
Plusieurs de ces décorations le sont hélas à titre posthume
La 3e compagnie du 7e B.C.L. est hors de combat. Elle ne sera pas reconstituée. Ses débris, avec ceux des 1ère et 2e compagnies entrent dans la composition d'une compagnie de marche qui continuera à se battre brillamment jusqu'à la fin de la campagne et vaudra au 7e Bataillon de Chars Légers une deuxième citation à l'ordre de l'Armée.


