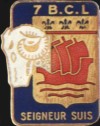|
|
HISTORIQUE DU 7e BATAILLON DE CHARS LÉGERS |
CAMPAGNE DE FRANCE 1939‑1940
I. FORMATION DU BATAILLON.
Issu du 1er bataillon du 503e R.C.C, qui tenait garnison à Versailles, le 7e bataillon fut constitué le 25 août. Dès le début de la mobilisation, l'ardeur de chacun laissait prévoir de beaux jours pour l'unité. Bataillon " très parisien " qui s'était signalé en temps de paix par des défilés impeccables, il devait plus tard prouver au feu que la brillante tenue antérieure est une condition nécessaire de " propreté morale " et que la " discipline char " est créatrice des plus beaux gestes. Le 503e R.C.C. n'avait‑il pas pour devise : " Du chic et du cran ". Commandé par un homme éminent, le 7e bataillon allait être à l'image de son chef, le commandant Giordani. Dût la modestie de notre chef en souffrir, il est indispensable de tracer ici les traits les plus remarquables de sa forte personnalité. Comment dépeindre le guerrier plus exactement que par le texte de cette magnifique citation, rédigée par le général Freydenberg, commandant la 2e armée :
"Chef de bataillon de grande valeur dont le bataillon de chars légers s'est couvert de gloire à chacun de ces engagements.
Déjà cité à l'Ordre de l'armée avec cette unité d'élite à la suite des combats devant Chémery et Bulson, a de nouveau donné, au cours des engagements du 10 juin, la pleine mesure de ses brillantes qualités de chef. "
Enveloppé de sa grande pèlerine, toujours le képi sur la tête, le commandant Giordani était, par son cran, un vivant exemple pour sa troupe, un entraîneur d'hommes exceptionnel. Il faut l'avoir vu le 10 juin, pour stimuler l'élan de l'infanterie, quitter, le stick à la main, debout sur la route, devant les chars, la base de départ de l'attaque, pour juger à sa mesure son absolu mépris du danger.
L'homme n'était pas moins admirable que le guerrier. Sachent maintenir une ferme discipline, il adorait ses chasseurs. Tous ses efforts étaient animés du même but : l'intérêt du bataillon. Prenant à tout instant ses responsabilités, défendant ses subordonnés avec une énergie farouche doublée d'une diplomatie habile, il avait su s'attirer la sympathie unanime et le dévouement absolu de tous. Le 7e bataillon n'était pas une unité quelconque, c'était le bataillon Giordani.
II. SÉJOUR DU BATAILLON AUX LOGES-EN‑JOSAS.
La mobilisation du bataillon fut terminée le 30 août, c'est‑à‑dire quatre jours avant la déclaration de guerre. Après avoir été passé en revue par le colonel Buisson, commandant le 503e R.C.C., puis par le colonel Welwert qui était à la tête de la brigade de chars, le bataillon se portait, dès le samedi 2 septembre, jour de la mobilisation générale, aux Loges‑en‑Jossas. Le cantonnement, distant de Versailles d'environ 15 kilomètres, avait un quadruple avantage :
‑ il permettait aux différentes unités de se souder, et à l'ensemble de prendre corps ;
‑ il dégageait le quartier de Satory au moment de l'afflux des réservistes ;
‑ il mettait éventuellement le bataillon à l'abri d'une attaque brusquée de l'aviation ennemie sur la région parisienne ;
- cependant, il ne rompait pas brutalement les relations avec la ville des Rois.
Lorsque fut déclarée la guerre, le dimanche 3 septembre, à 17 heures le bataillon était encadré de la façon suivante :
|
Chef de bataillon : commandant Giordani ; |
Compagnie d'échelon. |
|
|
1ère compagnie |
2e compagnie. |
3e compagnie. |
Le stationnement du bataillon aux Loges‑en‑Jossas fut mis à profit par les compagnies pour aménager les véhicules et régler définitivement les derniers détails avec le dépôt 503 et le centre mobilisateur. La 3e compagnie se distingua tout particulièrement en adoptant Mme la vicomtesse de Maublanc, marraine, qui se montra très généreuse envers les chasseurs du capitaine Chazalmartin. Le premier cadeau fut un chien magnifique qui devait perpétuer le souvenir du légendaire " Totoche ".
Le 5 septembre, avant‑veille du départ aux armées, le 7e bataillon eut l'honneur d'être passé en revue par son ancien colonel, le général Stehlé, directeur de l'infanterie, accompagné du colonel Perré, l'animateur de l'arme des chars. Le bataillon prouvera plus tard au combat qu'il savait être digne d'une semblable preuve d'estime.
Le 6 septembre, dans la cour du château des Loges, le commandant Giordani passa lui‑même son bataillon en revue et le fit défiler devant le commandant Cornic, ancien chef d'état-major qui, lors de la convocation verticale d'avril, avait su s'attirer la sympathie de tous.
Le fanion du bataillon fut présenté officiellement à ceux qui allaient avoir l'honneur de défendre sa gloire. Chacun fit intérieurement serment de se battre avec l'énergie la plus farouche pour l'embellir de nouvelles citations, afin de le léguer un jour, plus brillant encore, aux futures générations.
III. DÉPART DU BATAILLON POUR LA ZONE DES ARMÉES
Le mouvement du bataillon pour la zone des armées commença le 7 septembre dès 6 heures du matin.
Il s'effectua en deux fractions :
A) Mouvement sur route pour la compagnie d'échelon et les éléments sur roues des compagnies de combat ;
B) Mouvement par voie de fer pour les chars et certains véhicules indispensable à la vie immédiate des éléments chenillés.
A) Mouvement sur route.
La colonne faisant mouvement par voie de terre était aux ordres du capitaine Raphel, commandant la compagnie d'échelon, Le 7 septembre à 6 heures, elle me mit en route, scindée en deux fractions :
‑ véhicules légers aux ordres du lieutenant Mourgeon ;
‑ véhicules lourds aux ordres du lieutenant Brun.
Les étapes parcourues furent les suivantes :
7 septembre : Loges‑en-Josas, Fontenay‑Trésigny.
8 septembre : Fontenay‑Trésigny, Les Essarts (près Sézanne).
9 septembre : Les Essarts, Courtisois (près Châlons‑sur‑Marne).
A Courtisois, le détachement fut rejoint par le lieutenant Jacquemont, qui, parti en reconnaissance avec le commandant Giordani, était porteur de l'ordre de mouvement fixant Milly et Murvaux comme cantonnement du bataillon dans la zone de concentration.
10 septembre : mouvement de Courtisois à Milly et Murvaux par le carrefour de Mazagran (ouest de Vouziers).
B) Mouvement par voie de fer.
Le bataillon disposait de deux trains. Embarquement quai de Satory le 8 septembre :
‑ le premier à 3h30 ;
‑ le deuxième à 17h30.
Sur le premier train furent embarqués les chars et certains véhicules des 1ères et 2e compagnies. Le détachement était sous les ordres du capitaine Waitzenegger, commandant la 1ère compagnie.
Sur le deuxième train furent embarqués les chars et certains véhicules de la 3e compagnie ainsi que plusieurs éléments lourds de la compagnie d'échelon, dont la remorque caterpillar et les trois tracteurs remorqueurs. Le capitaine Chazalmartin commandait le détachement.
Le capitaine Valude, chef d'état-major du bataillon, après avoir assisté à l'embarquement des deux détachements, devait rejoindre le soir même le commandant Giordani sur la base de concentration et rendre compte des incidents.
Le commandant, parti le 7 au matin, a assisté à l'étape du détachement faisant mouvement par voie de terre et vérifié son installation à Fontenay‑Trésigny. Le 3, il a rejoint la base de concentration pour préparer le cantonnement des unités.
Le premier détachement débarqua en gare de Stenay dans la nuit du 9 au 10 septembre, le deuxième au début de l'après-midi du 10 ; ils se rendirent par voie de terre à Milly et Murvaux ou le bataillon fut regroupé.
Le bataillon était à la disposition de la 2e armée (général Huntzinger), laquelle était composée en majeure partie de troupes de la région parisienne.
Le commandant des chars de l'armée était le général Bourguignon, qui avait été autrefois lieutenant colonel au 503e R.C.C.
Le 7e bataillon formait avec le 3e bataillon (ex 2e bataillon du 503e R.C.C.), le G.B.C. 503 sous les ordres du lieutenant‑colonel Fleury.
IV. CANTONNEMENT A MILLY‑SUR‑BRADON ET MURVAUX.
Dès le dimanche 10 septembre au matin, les unités commencèrent leur installation dans leurs cantonnements respectifs. Tandis que Milly abritait le P.C, du bataillon et la compagnie d'échelon, les compagnies de combat s'étaient vu partager le village de Murvaux. Distants l'un de l'autre de 4 kilomètres, les deux villages, construits au bas de la forêt de Woëvre, allaient abriter le bataillon un peu plus de deux mois. La population, froide au premier abord, se montra très rapidement accueillante.
Dans le cantonnement, les unités poursuivirent leur instruction. Un champ de tir fut aménagé au sud-est de Murvaux qui permit ainsi aux équipages de conserver leur entraînement.
De son côté le matériel fut l'objet d'un soin particulier, et, grâce à un clairvoyant ravitaillement en pièces de rechange, les chars furent mis au point et les camions aménagés.
Un certain nombre de reconnaissances d'emploi et d'exercice en salle complétèrent, d'autre part, l'instruction des cadres.
Si la valeur du combattant est fonction de son degré d'instruction militaire, elle l'est encore davantage de sa préparation morale. Aussi, toutes les compagnies firent‑elles des prodiges pour aménager chacune une coopérative où les hommes pouvaient se réunir, écrire en toute tranquillité et acheter à bon prix différente articles de nécessité courante.
Gérés par la troupe, sous la direction d'un officier, ces organismes obtinrent un vif succès, d'autant plus que les bénéfices permirent de venir en aide aux chasseurs nécessiteux.
Le 11 novembre allait donner au bataillon l'occasion de montrer que son séjour dans la zone des armées ne lui avait rien enlevé des brillantes qualités qui, dès le temps de paix avaient fait sa réputation. Admis à l'honneur de défiler devant le général Huntzinger, commandant d'armée, et un certain nombre d'officier, des Etats‑Unis, dans le cimetière américain de Romagne‑sous‑Montfaucon, en hommage aux 14 000 tombes qui bordent de part et d'autre l'immense nécropole de nos alliés de la grande Guerre, il eut à cœur de présenter une revue digne de ses traditions.
Cependant le chef de bataillon reste à Tronville jusqu'à la fin de bataillon se vit récompenser par l'attribution du cantonnement de Verdun, comme quartier d'hiver.
Dès le 12 novembre chacun se mit donc en devoir de préparer le départ. Nombreux étaient ceux dont le cœur était bien gros de quitter la région de la ville de Stenay, dont l'horloge possède un magnifique carillon qui précède la sonnerie des heures en jouant des airs variés. De si sincères amitiés, une solide sympathie avaient réuni civils et soldats à Milly et à Morvaux. Aussi, le 7e bataillon conservera-t-il longtemps le très doux souvenir des premiers jours de guerre vécus au sein de ce charmant "coin de Meuse".
V. CANTONNEMENT A VERDUN.
Le 19 novembre consacrera le départ du bataillon pour Verdun.
Le nouveau cantonnement allait présenter un triple avantage :
‑ il permettait à la troupe de s'installer confortablement au quartier Villars, dans la belle caserne du 6e régiment de cuirassiers ;
‑ la ville de Verdun offrait de grandes commodités d'approvisionnement et facilitait les départs en permission ;
elle offrait au matériel un abri précieux pour la durée de l'hiver, ainsi que l'entretien et les diverses réparations en seraient facilités, d'autant plus que la proximité immédiate du parc de chars d'armée rendait possible l'échange et la perception des diverses pièces usées ou cassées.
D'autre part le terrain de manœuvres de la Chaume et le champ de tir de Douaumont permirent de poursuivre l'instruction des unités. Enfin l'établissement d'une " Carte char ", de la région donna aux cadres l'occasion d'étudier les terrains particuliers favorables à l'action des blindés dans la zone de l'armée.
Ainsi, mieux qu'à Milly et Morveux, le bataillon fut‑il à même de poursuivre une instruction complète : morale, pratique et tactique.
Quatre mois durant le bataillon restera dans la glorieuse ville de François Chevert, L'immortelle cité qui du 21 février 1916 au 1er février 1917, fit connaître à la France un esprit de croisade, épuisant les forces ennemies comme le fait une blessure qui ne se ferme pas, inculqua à chacun le souffle du devoir et sa vaillance fit écho dans les cœurs des gars des chars.
Préparation morale particulièrement efficace que de revivre l'héroïsme du passé sur la terre riche et endeuillée du sang des pères.
Malheureusement, dès le début de l'arrivée à Verdun, plusieurs départs vinrent attrister notre unité.
Les capitaines, Raphel et Chazalmartin, appelés à suivre le cours d'état-major, quittèrent le bataillon, unanimement regrettés. Ils restèrent de cœur avec le 7e, qui, de son côté, est fier de les avoir comptés dans sa trop brève histoire. L'impulsion que ces deux officiers avaient donné à leurs compagnies respectives, resplendira d'un vif éclat le jour de leur premier engagement, et, à ce titre, se justifie la mention que leur donne cet historique.
Le lieutenant Drouard, officier des détails, qui avait guidé avec bienveillance et méthode les comptables des unité dans la mise sur pied de la comptabilité du bataillon et rendu à ce titre de précieux services, était affecté à l'état‑major des chars de l'armée.
Le lieutenant Mourgeon, officier d'approvisionnement, qui par son activité jamais en défaut avait procuré au bataillon tout ce qui lui était nécessaire, dans une période difficile d'organisation, était rappelé à l’intérieur ; sachant prévoir et réaliser avec le sourire, il laisse à tous le souvenir d'un camarade dévoué et d'un animateur infatigable.
Quelques jours plus tard, le lieutenant Jacquemond, adjoint technique, dut rejoindre le dépôt de chars 502 à Angoulême. Ayant organisé son service avec une clairvoyance exceptionnelle, son départ fut unanimement regretté.
Quelque temps après, l'arrivée d'un certain nombre d'officiers combla en partie les vides.
Le capitaine Mignotte prit le commandement de la 3e compagnie. Officier breveté d'état‑major, il s'avérera au combat brillant entraîneur d'hommes.
Le sous‑lieutenant Jolly, jeune "bazar" venant de l'École, fut affecté à la 1ère compagnie, ainsi que l'aspirant Crémieux‑Bach. Le sous‑lieutenant Pagés et l'aspirant Loiseau furent affectés à la 3e compagnie.
Régulière et continue, telle fut la caractéristique de la vie du bataillon à Verdun. Malgré la rigueur de l'hiver, tout le matériel, grâce à des soins vigilants, fut conservé en parfait état de marche. Aussi, dès le début d'avril. le 7e bataillon fut il appelé au camp de Mourmelon pour l'instruction des troupes de passage
VI. PÉRIODE D'INSTRUCTION AU CAMP DE MOURMELON.
Depuis le débat de la campagne, le 7e bataillon se trouvait en réserve générale de la 2e armée. Par note n° 1829/1 chars S. de l'Inspection des chars, en date du 28 mars, il fut, tout en conservant sa destination tactique, "détaché en permanence au camp de Mourmelon pour participer :
1° Aux exercices en commun, infanterie‑chars, avec les D.I. qui se succédaient au camp à la cadence d'une par semaine ;
2° Aux exercices du cours des chefs de bataillon d'infanterie ;
3° Aux manœuvres des division cuirassées."
Dès lors commence pour les différentes unités une période d'instruction intensive qui s’avérera infiniment profitable. Les régiments d'infanterie se succèdent chaque semaine et mettent tour à tour au point leurs troupes en vue du combat de chars. Le 7e bataillon se dépense sans compter. Il présente chaque jour sur le terrain le maximum d'appareils. Ses équipages consolident leur cohésion. Les différentes unités se soudent davantage. Après la vie de garnison de Verdun, les manœuvres intensives du camp retrempent les hommes dans l'action et les préparent directement aux combats prochains. L'entraînement physique se développe opportunément. seul le matériel souffre un peu des exercices incessants. Les pièces de rechange sont difficiles à trouver. Les équipes de réparation travaillent jour et nuit de façon à satisfaire les besoins des régiments d'infanterie qui utilisent chacun au maximum leur semaine de manœuvres successives avec le 7e bataillon.
Au cours de ce séjour le bataillon eut le plaisir de retrouver son ancien commandant de régiment au 503, le colonel Buisson, qui commandait l'infanterie de la 3e division.
Trois dates marquent tout particulièrement ce cantonnement :
- le 9 avril, le colonel Buisson fit au bataillon l'honneur de le passer en revue prouvant ainsi sa sympathie pour l'ex. 1er bataillon du 503e R.C.C. ;
- le 14 avril, le général Brocard, commandant la 3e D.C.r., qui avait commandé autrefois le bataillon, de 1937 à 1939, eut également à cœur de se le faire présenter ;
- le 18 avril, fut exécutée, en liaison avec le 3e régiment de tirailleurs marocains, commandé par le colonel Desré, une manœuvre particulièrement réussie devant le général Touchon, commandant l'armée de réserve et ancien commandant de l'Ecole des chars.
Le bataillon poursuivait ainsi de façon intensive son instruction lorsqu’il fut surpris, le 10 mai, par l'attaque aérienne brusquée du camp de Mourmelon.
Alerté le même jour, à 10h30, alors qu'une compagnie travaillait encore sur le terrain, il reçut l'ordre de se porter immédiatement dans la région de Vouziers et se vit attribuer le cantonnement des Alleux.
Au début de l'après‑midi, le commandant Giordani, qui était en permission, rejoignit le bataillon.
VII. CANTONNEMENT DES ALLEUX.
Tandis qu'à 10 heures les échelons sur roues s'ébranlent, les chars des 1ères et 2e compagnies embarquent par voie ferrée ; ceux de la 3e compagnie doivent embarquer un peu plus tard.
Les échelons sur roues arrivent en fin d'après-midi aux Alleux (9 kilomètres nord de Vouziers) et les compagnies commencent à s’installer.
Tandis que les véhicules emplissent les granges des fermes, des emplacements camouflés sont préparés pour accueillir les chars dont le premier train est attendu à Vouziers au début de la nuit.
Celle-ci est très avancée quand les chars des compagnies Waitzenegger et Join-Lambert arrivent en gare de Vouziers. Ils sont aussitôt dirigés sur les positions d'attente préparées et quand le jour me lève il ne reste aucune trace de leur passage. L'aube du 11 mai se lève sans que le régulateur de Vouziers puisse donner des nouvelles du second train. Le capitaine Mignotte s'inquiète de ses chars et fait plusieurs fois la navette entre les Alleux et Vouziers.
A 9 heures un premier renseignement : le train portant les chars de la 3e compagnie a été bombardé en gare de Mourmelon, mais on ne signale aucun dégât ni dans le matériel ni dans le personnel. A 10 heures le régulateur fait savoir que la voie ayant été coupée par une bombe, le train a été dérouté par un itinéraire excentré et arrivera vers 13 heures. A 13h30, le convoi entre en gare ; le commandant de la 3e compagnie pousse un soupir de soulagement quand le lieutenant Chassedieu, commandant le train, lui annonce que personnel et matériel sont au complet. En vingt et une minutes, tout est débarqué et les chars, sons la menace d'apparition d'avions ennemis (la gare de Vouziers ayant été bombardée dans la matinée), gagnent la position d'attente individuellement, L'itinéraire a été soigneusement jalonné et les appareils disparaissent sous la futaie sans avoir été repérés.
Chacun travaille avec ardeur et joie pour mettre le matériel au point pour l'engagement que le survol incessant de la région par les avions allemands laisse prévoir imminent. Les bombardements se succèdent à la cadence de trois par jour. Aussi chacun vécut-il dans la fièvre. L'avance ennemie en Belgique devenait inquiétante. Ses forces menaçaient Sedan.
Le 13 mai à 16 heures, par ordre n° L‑1242 du général Bourguignon, commandant les chars de la 1ère armée, le 7e bataillon fut mis à la disposition du Xe corps d'armée.
Le même jour, à 17h30, par note n° 1504 de l'Etat-Major, 3e Bureau, du Xe C. A., le bataillon reçut l'ordre de se porter dans le bois de Haye qui se trouve entre Bulson et Chémery, à environ 7 kilomètres sud de Sedan.
Aussitôt le chef de bataillon prescrit aux unités de se tenir prêtes à faire mouvement à la tombée de la nuit et aux commandants de compagnie de venir le plus tôt possible au P.C. du bataillon pour partir en reconnaissance.
La nouvelle est accueillie avec calme. Tout le monde est prêt. Les petites réparations en cours sont achevées, les dernières mises au point sont faites tandis que le chef de bataillon et les commandants de compagnie partent pour le bois de Haye. A La Blanche‑Maison, munis des dernières instructions du commandant Giordani, les trois capitaines se séparent pour déterminer le point exact où leur compagnie ‑ du moins ils le croient ‑ va attendre le moment de combattre. Le temps est magnifique, le muguet foisonne dans le sous-bois où les roulantes de l'infanterie en ligne préparent le repas du soir. Il est 18h30. C'est le calme avant la tempête.
A 20 heures, le commandant et les capitaines son de retour aux Alleux. Tout est prêt pour le départ.
VIII. ENGAGEMENT DU 7e BATAILLON LE 14 MAI A CHEMERY‑BULSON
A) Mouvement du bataillon.
Dès 20h30, la 1ère compagnie s'est mise en marche, suivie respectivement à 15 minutes par les 2e et 3e compagnies.
L'itinéraire suivi empruntait la Route nationale 77 par le Chesne - Tannay ‑ Chémery.
Ce déplacement fut effectué dans des conditions particulièrement pénibles.
A partir du Chesne jusqu'à Tannay la route était encombrée par de très nombreux véhicules automobiles venant du nord et appartenant à l'artillerie. Les chars ont beaucoup de peine à passer.
Au delà de Tannay la situation devait empirer. Le chef de bataillon qui, accompagné de son officier de renseignements, le lieutenant Delorme, avait devancé la colonne chars, s'arrête à environ 200 mètres de la sortie nord de Tannay pour voir passer ses compagnies. Ne les voyant pas arriver, il essaie de retourner en arrière pour se rendre compte des conditions dans lesquelles s'effectue la marche ; les colonnes suivent avec peine.
Aux environs de 23 heures, le chef de bataillon, commandant le 7e bataillon, est rejoint par le capitaine Valude qui lui transmet, de la part du G.B.C. 503, l'ordre suivant :
"Le 7e bataillon s'arrêtera sur la ligne Chémery ‑ Maisoncelle, liaison à prendre avec le général Lafontaine, dont le P.C. est à Chémery."
Dès lors le commandant Giordani se dirige sur Chémery où il est mis au courant de la situation. Il a dû se frayer la route lui‑même, les éléments d'artillerie et d'infanterie l'ayant encombrée de toutes parts avec leurs voitures et leurs chevaux. Ce n’est qu'au bout de trois heures trente de marche, qu’assisté du lieutenant Delorme, il arrive au P.C. du général Lafonfaine qui le met au courant de la situation.
L'ennemi, après avoir franchi la Meuse, s'est emparé hier soir des hauteurs sud de Sedan. A la tombée de la nuit il avait atteint la ligne Bulson ‑ Chémery. La 55e division ne dispose plus que d'un régiment d'infanterie (le 213e), à effectifs réduits, et de 2 batteries d'artillerie.
Dans le but de rejeter l'ennemi dans la Meuse, ou tout au moins de l'empêcher de s'emparer du massif du bois de Mont‑Dieu (car les réserves ne pourront arriver sur cette position avant le 14 au soir, leur contre‑attaque est prévue pour le 14 au lever du jour. Elle sera menée, à droite, par le 205e R.I. et le 4e bataillon de chars et, à gauche, par le 213e R.I., appuyé par le 7e bataillon de chars.
L'attaque comportera trois phases :
1° S'emparer des hauteurs boisées au sud de la route Bulson – Chémery ;
2° S'emparer des hauteurs des bois de la Marffée et de la Croix-Piot ;
3° La Meuse.
Mais, comme le 205e R.I. et le 4e bataillon de chars ne sont pas encore annoncés et qu'ils risquent de ne pas arriver à temps pour prendre part à l'attaque et que, d'autre part, on ne peut retarder l'heure H de crainte d'être devancés par l'ennemi, le 213e régiment d'infanterie et le 7e bataillon attaqueront seuls sur tout le front au cours de la première phase pour s'emparer le plus tôt possible des hauteurs boisées au sud-ouest de Bulson.
Aussitôt le chef de bataillon envoie un motocycliste porter aux commandants de compagnie l'ordre de le rejoindre immédiatement et de pousser leurs chars le plus avant possible de façon à être à Chémery avant 4 heures.
Peu après, les 1ères et 2e compagnies envoient un agent de liaison rendre compte qu'elles ont atteint les lisières nord du bois du Mont‑Dieu ; Il est 3h30.
Aucune nouvelle de la 3e compagnie, qui a été coupée des deux autres par une cohue indescriptible. La route est complètement obstruée par des équipages de fuyards et des voitures de réfugiés civils. Mais elle arrivera quand même à temps, grâce à la ténacité de ses équipages. Quittant une route impossible, c'est la progression dans la nuit noire à travers les clôtures, les haies, les fossés. Il est 4h30, à la pointe du jour, quand elle atteint le bois du Mont‑Dieu, où le capitaine Mignotte reçoit l'ordre du chef de bataillon. Laissant le soin au lieutenant Héraud, son adjoint, d'amener coûte que coûte la colonne de chars à Chémery dans le plus court délai, le commandant de la 3e compagnie bondit à moto à Chémerv où il reçoit les ordres du commandant Giordani et prend contact avec le colonel Labarthe, commandant le 213e R.I.
Les compagnies de combat ont donc mis plus de cinq heures pour effectuer les cinq kilomètres qui séparent Tannay de Chémery. Plusieurs officiers, revolver au poing, ont dû frayer constamment le passage de leurs appareils au milieu des chevaux et des voitures de troupe se repliant dans le désordre le plus complet.
B) Combat du bataillon.
1° Mission et dispositif d’attaque du bataillon.
Partant de la ligne Chemery ‑Maisoncelle le 7e bataillon, en liaison avec le 213e R.I., attaquera à 5 heures, en vue de s’emparer des hauteurs boisées au sud de la route Bulson ‑ Chémery.
Le dispositif du bataillon au départ de l'attaque est le suivant :
UNITE 3e COMPAGNIE 1ère COMPAGNIE 2e COMPAGNIE
Zone des P.D.
Sur la route de Chemery-Chehery à la sortie N.O. du village de Chehery
Ravin de la Nacelle (au N.E. de Chémery Vergers bordant au nord Maisoncelle et Villers.
Heure de départ : 5 heures.
(L'heure H a été retardée pour permettre aux bataillons d'infanterie de se ravitailler en munitions. Ceux‑ci ne disposent cependant que de très peu de cartouches ; leurs effectifs sont en outre, fort réduits et leur dotation en armes antichars nulle.)
Dans le cas où le 205e R.I. et le 4e bataillon de chars seraient arrivés avant l'heure H, ils prendront leur place dans le secteur de droite, le bataillon du 213e et la 2e compagnie de chars du 7e bataillon passant en réserve derrière le groupement du centre.
2° Déroulement du combat.
En fait, l'attaque ne débouche qu'à 6h20. Jusqu'à 7 heures, la progression s'effectue sans trop de difficultés.
a) Premier bond.
3e Compagnie.
A l'ouest, la 3e compagnie progresse à cheval sur la route Chémery - Chéhéry. Le temps ayant manqué pour donner des instructions aux chefs de sections, le capitaine fait manœuvrer sa compagnie au fanion. Il faut gagner l'ennemi de vitesse. La section du sous‑lieutenant Pagés est arrivée en tête ; elle y demeure et reçoit l'ordre de progresser sur l'axe de la route.
Les autres sections sont encore dans Chémery, mais déjà ramassées, et prêtes à s’élancer. Le lieutenant Héraud doit prévenir le sous‑lieutenant Lacroix, chef de la 3e section, et l'aspirant Loiseau, chef de la 2e section, de se déployer en bataille de part et d'autre de la section Pagés en se conformant à l'attitude du capitaine. La 4e section, commandée par le sous‑lieutenant Levitte, suivra en réserve à quelque distance, prête à intervenir en cas de besoin.
Les premiers chars ont parcouru quelques centaines de mètres quand ils sont pris à partie par une pièce antichars située prés de la route à 500 mètre, au nord de Chémery. Instant de surprise et d'émoi. Tous les chars s'arrêtent, c'est le baptême du feu terrestre.
Mais le flottement ne dure pas, Tandis que la section Pagès riposte sur l'engin ennemi, le capitaine s'élance dans la prairie en ordonnant en bataille avec son fanion. La section Lacroix voit le signal et s'engage sur les traces du char de commandement, mais la section Loiseau n'a pas vu le petit fanion vert et blanc. Elle reste sur la route derrière la section Pages empêchant le débouché de la section Levitte.
Le commandant de compagnie revient en arrière et se plaçant près des sections Levitte et Loiseau il recommence le signal en bataille. Le lieutenant Levitte se rendant compte de l'appel que lui adresse son chef bondit littéralement avec son char et vient se placer à côté de celui du capitaine et entre en liaison à voix. Il reçoit l'ordre de se tenir à gauche et de couvrir le flanc le long de la rivière La Bar. La section Loiseau procède par imitation et quand le char de commandement reprend la tête il est suivi par la compagnie déployée. Le char de Pagès n'a pas cessé de subir le feu de l'ennemi pendant cette manœuvre. Un obus lui a brisé une chenille et toute la section est bloquée sur la route. Un autre obus a atteint un char subordonné blessant le chef de char, le caporal‑chef Jacquesson, en provoquant la chute des épiscopes.
A ce moment une deuxième pièce antichars se révèle un peu plus loin dans le fossé de la route. Mais cette fois la compagnie est lancée et les deux engins ennemis sont détruits en très peu de temps par la concentration de feux des chars. Les lisières sud et ouest du bois de Naumont sont neutralisées et tout le terrain jusqu'à l'embranchement de la route de Connage, est bientôt vide d'ennemis. Mais les quelques fantassins qui composent l'infanterie n'ont pas suivi et les chars doivent revenir en arrière pour tenter de les entraîner. Assis sur sa porte de tourelle pour bien montrer que tout danger est écarté, le capitaine Mignotte exhorte les fantassins à le suivre et c'est ainsi que quelques hommes du bataillon d'infanterie se portent vers le bois de Naumont et les haies qui bordent la Bar.
1ère compagnie.
Au centre est, les deux sections (1ère et 2e) du premier échelon de la 1ère compagnie ont atteint la cote 703 et Blanche‑Maison après avoir détruit 7 mitrailleuses ennemies.
2e compagnie
A l'est, les quatre sections de la compagnie, ayant débouché en ligne dans l'ordre de la droite à gauche : 1ère, 2e, 3e, 4e, se sont portées sur la crête du Fond‑Dagot. Aucune arme ennemie n'a été rencontrée au cours de cette progression et cependant, en dépit de plusieurs tentatives des chars revenant en arrière chercher l'infanterie d'accompagnement, celle‑ci n'a pas pénétré dans le bois qui domine la crête.
A 7 heures, la ligne atteinte par le bataillon de chars passe donc de l’ouest à l’est, par :
les lisières sud-ouest du bois de Naumont (3e compagnie) ;
le bois de Blanche-Maison et la côte 304 (1ère compagnie) ;
la crête du Fond‑Dagot (2e compagnie).
La ligne occupée par l'infanterie est sensiblement la même, sauf à l'est, où le 1/213 n'a pas pénétré dans le bois du Fond‑Dagot.
b) Deuxième bond.
3e compagnie.
A l'ouest, pendant que la section Levitte continue le long de la Bar, la couverture du flanc gauche, le capitaine Mignotte se porte en tète des 2e et 3e sections sur le village de Connage. La section Pagès éprouvée par le feu des engins antichars essaie de réparer des avaries aidée en cela par le lieutenant Chassedieu, chef de la section d'échelon, qui, sans attendre que le feu se soit tu s'est porté bien en avant de l'infanterie pour tenter le dépannage du char de Pagès.
Les lisières sud du village de Connage sont rapidement atteintes.
Les fantassins ennemis ont reflué et n’opposent plus aucune résistance.
Une batterie ennemie antichars est installée sur le mamelon immédiatement au nord‑est de Connage. Les chars qui sont aux lisières du village échappant à son tir mais la section Levitte plus en arrière le long de la Bar est durement éprouvée. Le char du chef de section, touché au persiennage, est immobilisé. Les deux chars subordonnés se portent à son secours et essayent de le remorquer malgré la vive canonnade de la batterie allemande.
Aucun élément d'infanterie n'a suivi les chars à Connage et, une fois de plus, il faut revenir en arrière pour prendre le contact.
Le char de l'aspirant Loiseau, touché par un obus au moment où il retournait pour prendre la liaison est mis en difficulté et s’embourbe au bord de la Bar, il ne reparaîtra plus et son équipage (mécanicien Cambier), incapable d'évacuer tellement le tir de la batterie est violent, sera fait prisonnier.
Six chars se retrouvent en arrière de l'étranglement de la vallée, là où la Bar vient frôler la route. La section Lacroix est au complet. Deux chars de la section Loiseau ont suivi le capitaine (ceux des sergents Le Tallec et Boitard). La bâche du char de Le Tallec, arrimée sur le côté de l'appareil, a été enflammée par un projectile. Dans l'ardeur de la lutte l’équipage ne s'est aperçu de rien et le feu risque de se communiquer au réservoir de gasoil. Le capitaine, voyant le danger, descend de son char, se porte vers l'appareil menacé et réussit à arracher la bâche enflammée. Aucun coup de feu ne se manifeste. Le terrain masque la batterie antichars. (ce que voyant, le sous‑lieutenant Lacroix sort à son tour de son appareil et vient prendre les ordres de son chef pour la suite de l'affaire.
Le sergent Le Tallec l'imite aussitôt,
Un peu en arrière et sur la gauche on voit le sous‑lieutenant Levitte à pied, dirigeant le dépannage de son char malgré les obus de la batterie antichars et même ceux des batteries terrestres qui commencent à donner de la voix.
Les ordres donnés par le capitaine Mignotte sont les suivants :
La section Lacroix progressera en tête sur l'axe de la route. Lignes à atteindre :
1° la route Connage – Bulson ;
2° les lisières de Chéhéry.
Le sergent Le Tallec prendra le commandement de la section Loiseau (réduite à 2 chars) et progressera à gauche et légèrement en retrait de la section Lacroix.
Le capitaine se placera au centre du dispositif au mieux des circonstances. Se tenir prêt à obéir au fanion du commandant de compagnie.
La section Levitte ne pouvant être atteinte par les ordres sera considérée comme momentanément en réserve. Le capitaine est sûr que le sous‑lieutenant Levitte, dont l'ardeur est proverbiale, le rejoindra dès que cela lui sera possible.
Tout ceci a demandé cinq minutes à peine et déjà Lacroix a bondi dans son char et démarre. Il vient de s'ébranler quand au détour de la route, à une centaine de mètres, un char ennemi apparaît et s'immobilise. C'est un engin d'environ 35 tonnes qui encombre la plus grande partie de la route. Le sous‑lieutenant Lacroix se précipite sur lui, s'arrête à 15 mètres et commence un feu nourri. Il est suivi immédiatement par un de ses chars, celui du sergent Corbeil, et par celui du sergent Le Tallec.
Le capitaine est encore en dehors de son char sur la route ; il arrête les deux autres appareils qui commençaient à s'ébranler et donne au caporal-chef Tirache (de la section Loiseau) et au sergent Boitard l'ordre de rester en arrière à 300 mètres environ pour appuyer de leurs feux les chars de tête. Puis il monte dans son appareil et va se placer à côté du char de Lacroix.
Le combat chars contre chars commence. Mais la lutte est inégale. De notre côté, six chars légers de 12 tonnes ; du côté allemand trois chars de 35 tonnes sont maintenant en avant et d'autres ne cessent de se déployer un peu en arrière. Le feu est ouvert de part et d'autre. Nos chars ne disposent chacun que de douze obus de rupture qui sont bientôt épuisés. Le tir continue à obus explosif. Ceux-ci aveuglent les chars allemands qui ne ripostent qu’avec une extrême lenteur. De nombreux obus ricochent sur le blindage des F.C.M., mais ceux qui arrivent de plein fouet le percent. C’est ainsi que le mécanicien Lintanff est grièvement blessé, un peu plus tard, c'est le tour, du sous‑lieutenant Lacroix.
Le combat se prolonge. Un char allemand est en flammes. L'ennemi met alors en oeuvre un canon plus important (calibre 75 environ) pointé dans l'axe de l'appareil. Ces projectiles tirés à bout portant sont extrêmement meurtriers. C'est d'abord le char de Corbeil qui est éventré à l'avant ; le mécanicien Lintanff qui, un obus de 37 logé à la base du cou continuait de passer les munitions à son chef de char, a le ventre ouvert et succombe. Imperturbable, le sergent Corbeil continue à tirer. Un second coup lui détériore son arme. Il sort alors de son char et s'abrite tant bien que mal dans le fossé de la route. Le char du sergent Le Tallec reçoit un obus dans la chambre du moteur et s’enflamme. Pendant plusieurs minutes l’équipage continue à tirer, puis la chaleur devenant intenable, il est obligé d’évacuer. Le Tallec et son mécanicien, le chasseur Audoire, s'échappent au plus fort de la bagarre et courant vers les buissons qui bordent la Bar, ils regagnent Chémery où ils sont recueillis par le lieutenant Héraud qui de loin assiste au combat.
Des quatre chars de tête, celui de commandement est seul encore en état de tirer. Deux obus de rupture ont pénétré dans la chambre du personnel, mais par miracle l'équipage est indemne. Le capitaine Mignotte prescrit à son mécanicien de faire demi‑tour sur place, à la fois pour avoir mie plus grande protection en se couvrant de toute la masse du moteur et pour être prêt à rompre méthodiquement un combat sans espoir. Le demi‑tour vient à peine d’être achevé qu'un gros obus arrache la chenille gauche et déplace le char de plusieurs mètres. Se rendant compte qu'il ne pourra tenir longtemps, le commandant de la 3e compagnie ordonne à son mécanicien, le chasseur Heinrich, d'évacuer en profitant d'un feu nourri qu'il déclenchera pour aveugler l'ennemi. Les deux chars restés en arrière se replient alors sur Chémery ; le char de Boitard est d'ailleurs momentanément hors de combat, son chef ayant été intoxiqué par les gaz de la mitrailleuse ; quand à celui de Tirache il ne se déplace que péniblement, un galet de son train de roulement droit ayant été arraché par un obus.
Après un instant d'accalmie le char français et les chars allemands reprennent le tir. Le char de Le Tallec brûle avec intensité et protège en partie par ma masse celui du capitaine. Les Allemands, dont les chars marchent à l'essence n'osent pas en approcher pour prendre dans l'axe de leurs gros canons le dernier char français et seuls les obus lancés des tourelles crépitent sur le blindage du char léger. Les derniers obus du char de commandement sont épuisés ; jusqu’à Chémery le terrain est vide d'amis. Tous les autres survivants semblent avoir réussi à rejoindre. Le capitaine Mignotte sort de son char par la porte avant sans aucune précaution : il est exténué et s’attend à tout. Surprise, les chars ennemis cessent le feu. Le sergent Corbeil, qui était toujours dissimulé derrière son talus, court vers son chef et l'entraîne vers la hauteur, vers le bois.
Une heure plus tard ils réussissaient à rentrer dans nos lignes.
Pendant que se déroulait cette action, la section Levitte (mécanicien Gicquel) tentait en vain de se dépanner. Un gros obus touche l'appareil de droite et en blesse mortellement le chef, le sergent-chef Werhle (mécanicien Arnaud). Le char de gauche commandé par le sergent Froussard, qui a reçu de son chef l'ordre de se replier, s'enlise dans un marécage, pendant que le sous-lieutenant Levitte, aidé de deux mécaniciens, les chasseurs Arnaud et Gicquel, essaye de ramener Werhle. Pris sous le feu ennemi, ils sont obligés de se jeter dans la Bar, où ils abandonnent le corps du malheureux sous-officier qui vient d'expirer. Ils restent toute la journée dans l'eau et rejoignent le bataillon le lendemain après avoir traversé les lignes allemandes durant la nuit.
Les pertes ont été sévères. Sur treize chars engagés, trois seulement rentrent dans nos lignes. Il manque :
le char de commandement ;
deux chars de la 1ère section ;
deux chars de la 2e section ;
deux chars de la 3e section ;
les trois chars de la 4e section.
1ère compagnie
Au centre est, la 1ère soutient une lutte non moins héroïque. Les 1ère et 2e sections se sont portées respectivement à l'ouest de la crête 322 et aux lisières sud des bois de Haye. Prises à partie par des chars ennemis, lourds et légers, embossés aux lisières sud‑est du bois de Haye et par des armes antichars situées au nord de la cote 322, elles engagent le combat. La 1ère section (aspirant Crémieux-Bach) qui est plus à l'est, supporte presque tout le choc. Elle immobilise deux chars allemands. Pendant que les sections de deuxième échelon qui, essayant d'entraîner l'infanterie, se sont portées, guidées par le commandant de compagnie, sur le bois de Blanche‑Maison, d'où elles débouchent, la 2e section (adjudant-chef Pierre) engage le combat contre les autres chars allemands qui avancent aux lisières sud‑est du bois de Haye.
Deux appareils sont touchés, mais le char de droite voit à deux reprises sa tourelle percée par des projectiles ; le chef de char, caporal Bruneval, est tué ; le mécanicien, chasseur Trouilloud, grièvement blessé, surmontant héroïquement ses souffrances, ramènera dans nos lignes son char et son chef, renouvelant un des exploits légendaires des anciens de l'artillerie d'assaut. La 2e section se replie jusqu'au bois de Blanche-Maison où, avec les 3e et 4e sections, elle résistera jusqu'à 10h30. Aucun char de la 1ère section, durement atteinte, n'a pu se replier.
Aux environs de 10h15, les éléments restants de la 1ère compagnie, sur l'ordre du chef de bataillon commandant le 7e, se sont repliés sur Artaise‑le-Vivier. A la traversée du village de Maisoncelle, occupé par les Allemands, ils ont été pris à partie par des armes antichars et des chars de types différents, venus par la route de Chémery, un obus a traversé le masque du char de tête.
Sur les treize chars engagés, quatre seulement sont revenus de la bataille :
‑ un de la 4e section ;
‑ deux de la 2e section (l'un avait la tourelle bloquée par un projectile) ;
- un de la 3e section.
2e compagnie
A l'est, l'engagement de la 2e compagnie est aussi violent. Pendant que la 1ère section protège le flanc droit en direction de Bulson, les 2e, 3e et 4e sections se portent à l'assaut de la cote 322, neuf chars conduits par le commandant de compagnie ont quitté leur position de départ.
Dès le débouché, six chars ennemis de modèles différents sont aperçus à la sortie de Bulson. Pris à partie par le seul groupe de 75 en position à Maisoncelle qui devait soutenir l'attaque de la division par du tir à vue, les appareils allemands se sont ralliés au nord de la crête 322, l’un d’eux a brûlé presque aussitôt. Le chef de la 3e section, lieutenant Leclair, se rue en avant pour livrer le duel, il franchit la crête 322 et quelques secondes après, son char, porte de tourelle ouverte, est vu en train de brûler.
C'est alors que s'engage une lutte sans merci entre, d'une part les neuf chars restants qui, conduits par le commandant de compagnie sont à défilement de tourelle au sud de la crête 322 et, d'autre part, les cinq chars, vraisemblablement des PzKW III, qui sont de l'autre côté. Nos chars se guidant sur les déplacements de l'antenne des engins ennemis, s'avancent pour tirer, puis se reportent à défilement de tourelle, ainsi se prolonge la lutte.
La masse des chars ennemis est ainsi immobilisée. Sous les effets des coups de chacun de nos obus de rupture, ils reculent mais ne paraissent cependant pas sérieusement atteints.
Plusieurs de nos chars sont cependant frappés par les projectiles ennemis. L'un d'eux dessouda la toiture de la tourelle du commandant de compagnie, un autre s'enfonça dans le blindage sans le perforer.
Vers 10h30, la compagnie reçoit l'ordre de se replier sur Artaise-le-Vivier.
Au passage de Maisoncelle, elle est prise à partie par des chars allemands, qui, venant de Chémery, lui barrent le passage.
Voyant Artaise également occupé par l'ennemi, la 2e compagnie se replie sur le bois de Raucourt et de là gagne les bois de Mont Dieu. Des treize chars engagés, trois seulement ont pu regagner la position de ralliement.
Comme à l'ouest, l'infanterie d'accompagnement n'a nullement essayé de profiter de la progression des chars, bien que de nombreuses résistances aient été neutralisées sur la crête 322.
3° Après le combat.
Vers 13 heures les chars restants sont regroupés dans le bois de Mont‑Dieu et constituent une compagnie de marche à deux sections sous les ordres du capitaine Mignotte, commandant la 3e compagnie. Cette unité reçoit mission, en s'embossant aux lisières nord du bois de Mont Dieu, de s'opposer à la progression de l'ennemi sur l'axe Chémery ‑ Tannay, jusqu'à l'arrivée de la 3e D.I.M. et de la 3e D.C.r.
Heureusement l'ennemi fortement impressionné par la résistance acharnée de la matinée n'ose pas exploiter son succès.
A 21 heures, la compagnie est libérée et rejoint le bataillon qui se regroupe à Olisy.
Ainsi le 7e bataillon avait atteint son but, l'ennemi, malgré son écrasante supériorité (3 Panzerdivisionnen : 1ère au centre, 2e à l’ouest et 10e à l'est) n'avait pu s'emparer du massif du bois de Mont‑Dieu - Stonne.
En lisant les rapports allemands on se rend encore mieux, compte des résultats obtenus par l'héroïque contre‑attaque du 7e bataillon.
Voilà en quels termes le commandant d'état-major de Kielmansegg, chef du 3e bureau de la 1ère Panzerdivision, dans un article paru dans Die Wehrmacht, du 21 mai 1941, relate les combats de cette journée :
« Si, dans la Meuse, c'est aujourd'hui la grande journée de la D.C.A., sur le front c'est la journée des blindés. Nous recevons sans cesse de nouveaux rapports qui signalent l’arrivée des renforts ennemis et des concentrations de blindés et c'est avec impatience que notre division aura attendu le moment de l'arrivée de nos blindés sur la rive sud de la Meuse, où ils sont prêts à entrer en action. Nous avons maintenant deux fronts, l'un vers l'ouest derrière lequel se rassemblent les éléments qui doivent avancer dans cette direction, et l'autre vers le sud, pour repousser les attaques ennemies qui se déclencheraient et même se déclenchent déjà. L'attaque vers l'ouest trouve devant elle, comme premier obstacle, le canal des Ardennes, dont le tracé est en direction nord-est. D'ailleurs, cette attaque ne peut commencer, tant que la situation au sud restera aussi peu claire qu'elle l'est pour l'instant.
Là, de furieuses contre-attaques ont commencé. Nos pionniers défendent péniblement, mais avec succès, contre des forces blindées ennemies le nœud important de Chémery, où la route s'infléchit vers l'ouest, en passant sur le pont encore intact du canal. La pointe de nos chars de combat se heurte, à Bulson, à des blindés français qui attaquent. C'est le premier vrai combat, chars contre chars, de cette guerre. Quelle en sera l'issue ? Après deux heures d'une lutte opiniâtre, les français évacuent le terrain, ayant perdu vingt chars. Un régiment d'infanterie, le n°.., auquel on fait interrompre son action contre une partie qui tient encore de la ligne principale de résistance sur la Meuse, arrive et continue l'attaque vers le sud, parvient engageant jusqu'à ses dernières forces, à avancer de 8 kilomètres en direction du sud en dépit de contre-attaques françaises, mais n'atteint pas, toutefois, son véritable objectif, qui était l'ensemble des hauteurs de Stonne. La possession de cette dernière position est très importante, elle doit garantir le flanc de mouvement que nous projetons vers l'est, tandis qu'aux mains des Français elle représenterait précisément une menace constante et considérable contre ce mouvement. Il n'est pas possible même avec des éléments de reconnaissance, de pénétrer dans le bois de Mont-Dieu, au nord de Stonne, ni dans les bois de Raucourt, tant il y a là de blindés français. Le soir, le régiment qui, à part les blindés, a eu la plus lourde tâche de la journée, constitue un front défensif vers le bois de Stonne. »
IX. DÉFENSE DE LA POSITION DE VONCQ.
Constitution d’une compagnie de marche.
La journée du 15 est employée à remettre de l'ordre dans les unités. Tandis que le P.C. du bataillon et les compagnies de combat restent à Olisy, la compagnie d'échelon va s’installer à 30 kilomètres plus au sud, dans les villages de Laval et de Wargemoulin pour travailler dans de meilleures conditions, à la remise en état du matériel.
Le 16, à 11h50, le bataillon est mis à la disposition de la 71e division d'infanterie, puis, à 16h15, il passe aux ordres de la 36e D.I. avec mission d'étayer la défense de l'Aisne à hauteur d'Attigny.
Un détachement est constitué sous les ordres du lieutenant Rougier. Il comprend cinq chars endommagés mais encore capables d'un effort, formant deux sections commandées par les lieutenants Chassedieu et Jolly. A la tombée de la nuit il est dirigé sur Chuffilly pour appuyer le 18e R.I. dans la défense des ponts d'Attigny.
Le lendemain ce détachement est mis à la disposition du 57e R.I. qui défend le canal des Ardennes entre Voncq et le Chesne. Les chars sont embossés à la lisière nord-ouest du bois de Voncq, face à l'ennemi dont les lignes sont visibles à quelques centaines de mètres.
Pendant ce temps, à l'arrière, les réparations s'activent et bientôt le bataillon peut mettre en ligne onze, puis seize appareils. Une compagnie de marche est alors formée le 27 mai, sous les ordres du capitaine Mignotte.
La vie de cette compagnie est très pénible ; aussi, un système de relève est organisé, et les hommes qui descendent des lignes vont au repos à Laval et Wargemoulin.
Cette solution qui incorporait les chars dans les rangs même des premières lignes de l'infanterie rendit de grands services aux troupes de la 36e D.I., donnant confiance au fantassin, lui assurant une collaboration immédiate des chars ; elle eut, par contre, l'inconvénient de fatiguer considérablement le matériel qui ne pouvait être entretenu que d'une façon rudimentaire.
Aussi, le 1er juin, la division ayant a peu près terminé son installation défensive, cette compagnie fut‑elle, à la demande du chef de bataillon, regroupée en position d'attente à Chestres. Sa mission était dès lors envisagée de la façon suivante :
1° Appuyer des contre attaques rapidement montées en vue de rejeter l'ennemi sur le canal de l'Aisne, si celui-ci réussissait à créer de petites têtes de pont au sud de la ligne d'eau, soit à l'est de l'Aisne, soit entre Semuy et Attigny ;
2° Appuyer des attaques à objectif limité, soit dons la clairière des Alleux, soit dans le couloir Quatre‑Champs – Noirval - Châtillon.
Durant cette période, le bataillon dut encore fournir un détachement de 10 équipages F.T. qui, aux ordres du sous‑lieutenant Jollv, furent mis à la disposition du G.B.C. 503. Un jour particulièrement glorieux marque cependant le séjour du bataillon à Olizy. Le 2 juin, en effet, eut lieu une brillante prise d’armes au cours de laquelle furent remises par les généraux Bourguignon, commandant les chars de l'armée, et Buisson, commandant la 3e D.C.r., les récompenses valeureusement gagnés au combat du 14 mai (6 légions d’honneur, 8 médailles militaires et 92 croix de guerre).
Ainsi, presque un mois durant, le bataillon ne connut-il aucun repos. Pendant que les éléments combattants étaient en ligne la compagnie d'échelon travaillait jour et nuit à Wargemoulin, pour remettre en état le maximum de chars récupérés à la suite du combat du 14 mai.
X. 7e BATAILLON A LA DISPOSITION DE LA 3e D.C.r.
C'est au milieu de cette fièvre, que le 7 juin, par ordre n° 17956/3 du corps d'armée colonial, le 7e bataillon fut mis à la disposition de la 3e division cuirassée, dont le P.C. devait s'installer à Sémide.
Le bataillon fit mouvement dans la nuit du 7 au 8 juin, pour se porter en position d'attente dans les bois de la Femme‑Enterrée (ravin nord de la route Contreuve - Sémide) cependant que le P.C. du bataillon s'installait au village de Contreuve.
La compagnie d’échelon et les éléments sur roues des compagnies de combat restèrent à Laval et Wargemoulin où était installé l'atelier.
Dès le 9 juin, en fin de matinée, le bataillon fut alerté pour faire une contre-attaque entre Suippes et Retourne. Les cadres effectuèrent aussitôt leurs reconnaissances, car l'opération devait avoir lieu dès le lendemain à l'aube.
Chacun faisait aux appareils les derniers préparatifs lorsque, le soir même, à 23 heures, arriva un ordre urgent du corps d'armée colonial, mettant immédiatement le bataillon à la disposition de la 36e D.I. dont le P.C. était installé à Vouziers.
Ainsi, axé sur la contre‑attaque en liaison avec la 3e D.C.r., le 7e bataillon allait, dans la fièvre des préparatifs, recevoir une mission très délicate : contre attaquer en moins de cinq heures à 20 kilomètres de là, dans une zone inconnue et sans avoir encore pris contact avec les troupes au profit desquelles il allait travailler. Aucun obstacle n'allait cependant l’arrêter. Quand une troupe veut se battre, elle en trouve toujours les moyens. Les équipages du bataillon allaient en donner la preuve éclatante.
XI. ENGAGEMENT DU 10 JUIN DANS LA REGION VRIZY ‑ ROCHE AU NORD DE VOUZIERS.
Lorsque, le 9 juin, à 23h15, le commandant du 7e B.C.C. reçut l'ordre :
‑ de se rendre au P.C. de la 36e D.I. ;
‑ de mettre immédiatement ses éléments combattants en marche sur Vouziers, le bataillon comprenait : 16 chars répartis en six sections de combat :
- deux sections de la 2e compagnie (sections à 3 chars) ;
‑ deux sections de la 3e compagnie (sections à 3 chars) ;
‑ deux sections de la 1ère compagnie (sections à 2 chars), groupées en une compagnie de marche sous le commandement du capitaine Join-Lambert.
La compagnie se mit en marche sur Vouziers à 23h45 pendant que le chef de bataillon se rendait au P.C, de la 36e D.I. à Vouziers où il arrive à 0h30.
Mis au courant de la situation par le général commandant la 36e D.I., il reçut l'ordre de contre‑attaquer en liaison avec le 3e bataillon du 5e R.I.C., les éléments ennemis qui, la veille, avaient franchi l'Aisne à Semuy et avaient atteint les bois de Vrizy, et de se porter le plus rapidement possible au P.C. du bataillon à Vrizy pour régler les détails de l'opération. Une contre‑attaque parallèle eu direction de Voncq devait être conduite avec l'appui du 4e bataillon de chars sur la rive droite de l'Aisne. L'opération combinée du 5e R.I.C. et du 7e bataillon de chars devait s'effectuer en trois bonds :
Premier bond : lisières nord du village de Roche, cote 105 ;
Deuxième bond : cotes 133 – 126 ;
Troisième bond : boucle de l'Aisne entre lisières est d'Attigny et lisières ouest de Semuy.
a) Marche d'approche.
Pendant que le commandant, accompagné du capitaine Join‑Lambert, se rendait au P.C. du bataillon d'infanterie, le lieutenant Delorme, adjoint au chef de bataillon, fut envoyé à la rencontre de la colonne de chars pour la guider. Sous un très violent tir d'artillerie, il la conduisit depuis Vouziers jusqu'à Vrizy. Un appareil (section Cassier) fut immobilisé par un obus. A 2h30, après cette marche pénible, les chars entraient dans Vrizy en flammes.
b) Déroutement du combat.
a) Dispositif au départ de la contre-attaque.
1° échelon.
A droite, en appui de la 2e compagnie du 3/5e R.I.C.
‑ section Levitte ;
‑ section Bavard.
A gauche, en appui de la 9e compagnie du /5e R.I.C.
‑ section Danne ;
‑ section Bauchneckt.
2° échelon.
Section Pierre.
Mission
1° Nettoyer les boqueteaux nord de la côte 122 ;
2° Progresser ensuite sur l'axe Roche ‑ Rilly, en situation d'intervenir à tout instant, soit sur la gauche, soit sur la droite.
La 5e section Cassier, réduite à deux appareils au départ, ne possède plus qu'un seul char, l'autre ayant été immobilisé sur la route au sud de Vrizy. L'appareil restant sera monté par le capitaine Join-Lambert
Servitude. ‑ Le ruisseau La Loire étant infranchissable, les chars passeront tous sur le pont sud de Roche (route Roche - Vrizy) imposant ainsi aux appareils un détour long et dangereux.
b) Le déroulement du combat.
Au cours de la marche d'approche depuis Vrizy, jusqu'à la base de départ (cote 112 ‑ chemin allant de la cote 112 à la côte 104) quelques résistances ennemies sont réduites. A 4h15, toutes liaisons prises avec les unités d'infanterie, les chars débouchent de la route, traversant les bois du marais de Loisy.
Premier bond : O1 - lisière nord du village de Roche, cote 105.
Favorisés par le brouillard, les chars avancent rapidement, neutralisant les résistances ennemies. Un avion ennemi suit à très basse altitude notre progression, la jalonnant par des fusées. Aussi, lorsque l'infanterie s'installe sur l'objectif, un violent tir d'artillerie est déclenché par les Allemands. La liaison infanterie-chars est cependant assurée et sur l'ordre du chef de bataillon, la progression reprise en direction de O2 malgré un bombardement intensif. Le sous-lieutenant Levitte et son mécanicien Arnaud sont tués à Roche.
Deuxième bond : O2 - côtes 122‑126.
A l'est. ‑ Peu après le départ, la progression des chars est gênée par de nombreux coups de feux semblant provenir du plateau de Voncq. Les boqueteaux au nord de la cote 105 sont cependant neutralisés et occupés. Les îlots de résistance du 18e R.I. encerclés depuis la veille à la ferme Fontenille sont dégagés par nos appareils. Mais en dépit de plusieurs tentatives des chars, l'infanterie ne parvient pas à déboucher des bois de la côte 105. A chaque tentative elle était aussitôt clouée au sol par des tirs violents d'armes automatiques venant de Voncq où l'attaque du 4e bataillon ne semblait pas réussir. Prises sous le tir de l'artillerie, les deux sections de chars opérant dans cette région ont quatre appareils touchés et immobilisés.
A l'ouest. ‑ Les deux sections de chars suivies par l'infanterie progressent jusqu'à la cote 133 et les bois environnants qu'elles neutralisent et occupent. Cinq appareils sur six sont touchés, soit par des armes antichar, soit par l'artillerie. Deux ont une chenille coupée, un autre reçoit un obus dans le moteur, deux autres sont immobilisés par le tir de l'artillerie. Apprenant vers 9 heures, que l'attaque parallèle du 4e bataillon de chars sur Voncq avait complètement échoué, que l'ennemi s'était infiltré dans les marais de Loisy, et, qu'enfin, malgré l'intervention de la section du 2e échelon, il était impossible de nettoyer le bois par suite de l'absence de troupe d'infanterie en réserve, les trois chars restants sont envoyés en D.C.B. à la cote 113 avec mission :
1° De rétablir la liaison avec la division ;
2° De protéger le dégagement du bataillon.
Le rétablissement de la liaison avec la division fut pénible; sur les trois chars, un seul, celui du capitaine, réussit à traverser les lignes ennemies et à rendre compte de la situation au général commandant la 36e D.I.
Quelques instants après, le bataillon, à son tour, rejoignait nos lignes.
Les éléments restants du 7e bataillon furent regroupés vers 15 heures dans la région de Vouziers.
XII. MOUVEMENT DE REPLI DU BATAILLON.
Dès le 10 juin au soir, le 7e bataillon n'ayant plus que quatre chars, d'ailleurs incapables de combattre, reçut l'ordre de se regrouper à Laval Wargemoulin on cantonnaient déjà la compagnie d'échelon et les éléments sur roues des compagnies de combat et de gagner le lendemain le cantonnement de Brizeaux, au sud de la forêt de l'Argonne.
Journée du 11 juin.
Mouvement depuis Laval et Wargemoulin jusqu'à Brizeaux.
Le mouvement, pour échapper aux bombardements de l'aviation, s'effectue en onze rames de véhicules, se déplaçant à quinze minutes d'intervalle l'une de l'autre.
a) Itinéraire. suivi par les véhicules sur roues : La Croix-en-Champagne, Auve, Saint‑Maud-sur Auvee, Gizaucourt, Braux‑SaintRémy, Villers.en-Argonne, Passavant, Brizeaux.
b) Itinéraire suivi par les véhicules sur chenilles : Laval, Hares, Valmy, Gizaucourt, Braux-Saint-Rémy, Brizeaux.
Le mouvement est terminé à 17 heures sans incident.
Journée du 12 Juin.
La journée du 12 juin est mise à profit pour remettre de l'ordre dans les unités et vérifier le chargement des véhicules.
Dans l'après-midi les événements se précipitent.
A 13 heures, le bataillon reçoit du G.B.C. l'ordre d'envoyer un camion d'essence ravitailler les unités du 67e bataillon en panne sur la route Sainte‑Menehould - Suippes.
A 19 heures, le G.B.C. envoie l'ordre de se replier sur Loisey et convoque le commandant au P.C.
En arrivant, le chef de bataillon apprend que :
1° Les Allemands ont franchi la Marne à Chalons, dans l'après-midi, et marchent à toute vitesse sur Vitry‑le‑François ;
2° Le P.C. de l'armée s'est replié de Verdun à Chaumont ;
3° Le P.C. du corps d'armée va se replier également.
A 2 heures, le général commandant les chars de l'armée prescrit au 7e bataillon de verser ses chars au parc de chars d'armée (élément avancé à Saint-Mihiel) et de se tenir prêt à faire mouvement pour aller percevoir d'autres appareils à l'arrière.
A ce moment le bataillon se trouve en mouvement à destination de Loisey, tous les chars étant indisponibles devront être transportés par camions ; il faudra faire deux voyages. Comme le cantonnement de Loisey est à proximité de Tronville où se trouvait le parc de chars d'armée (élément lourd), le commandent prescrit aux différentes rames de pousser jusqu'à Tronville, d'y verser les chars au parc d'armée et de se tenir prêtes à faire mouvement vers le sud.
En même temps il adresse au général commandant les chars de l'armée le compte-rendu suivant :
"En exécution de votre ordre du 12 juin, à 17 heures, les chars restants du bataillon étant tous indisponibles, seront versés au parc de chars et embarqués avec lui sur le train. Les événements survenus après la réception de votre note m'ont incité à ne pas retenir près du parc le personnel n'ayant plus de chars. Je resterai au parc jusqu'à ce que les derniers appareils soient arrivés et embarqués. Les compagnies de combat et la compagnie d'échelon sont dirigés d'urgence sur les environs de Chaumont (compagnie échelon à Andelot, compagnies de combat à Saint‑Blin)."
Signé : Giordani
Le regroupement à Tronville s'exécute assez péniblement, à cause de l'encombrement des routes ; ce n'est que le 13 juin, à 5 heures, que les derniers détachements arrivent à destination.
Journée du 13 juin.
Les camions porte‑chars, après avoir déchargé les premiers appareils en gare de Tronville, sont partis chercher les autres à Brizeaux ; leur retour est prévu pour 11 heures.
Le commandant donne l'ordre de laisser au parc des chars d'armée, sous le commandement du lieutenant Wallart, le détachement chargé de l'embarquement des chars ; la compagnie d'échelon fera mouvement à destination d'Andelot par l'itinéraire Ligny, Villers-le-Sec, Dammarie, Montiers, Efrincourt, Germay, Epizon, Busson : les compagnies de combat gagneront Saint-Blin, par Ligny-en-Barrois, Ménancourt, Mevilliers, Biencourt, Saudron, Aifontaine, Lezeville, Germay, Morionvillers, Chambroncourt, Leurville, Orquevaux, Humberville.
Cependant le chef de bataillon de reste à Tronville jusqu'à la fin de l'embarquement. A 13 heures, l'embarquement terminé, il rejoint le gros du bataillon, vérifie l'installation des unités et leur prescrit de se reposer après avoir refait les pleins des véhicules.
Puis, dans la soirée, il se rend au PC. du général commandant les chars de l'armée, à la lisière du bois de Château‑Villain (15 kilomètres sud de Chaumont) ; il y apprend que les Allemands ont dépassé Vitry-le-François et reçoit l'ordre de poursuivre, dès le lendemain matin 14, le mouvement de repli et de s'installer dans la région sud du P.C.
Revenu aussitôt à Andelot, il donne ses instructions pour le mouvement du lendemain..
Journée du 14 juin..
Le bataillon ira cantonner à Villiers et Leffonds (20 kilomètres sud de Chaumont). Départ de la première rame à 7 heures. Vers 9 heures, alors que les derniers éléments quittent le cantonnement d'Andrieu, le commandant apprend que les Allemands, suivant la vallée de la Marne, marchent sur Chaumont et ont atteint Joinville à 30 kilomètres nord-ouest d'Andelot. Au même moment, des avions italiens viennent bombarder le cantonnement.
Le commandant Giordani donne aussitôt aux unités l'ordre de presser le mouvement, d'éviter Chaumont bombardé et de passer à l'est de la ville. Puis il se rend, sans tarder au P.C. du général commandant les chars de l'armée. Là il apprend que le P.C. se déplace et reçoit l'ordre de gagner Autun. Revenu à Leffonds, le commandant réunit les capitaines et leur explique la situation. Il décide alors, étant donné les événements, de ne pas s'arrêter à Villiers‑I,effonds et de porter d'un seul bond les unités au sud de la route de Langres, Châtillon‑sur-Seine. Il fixe comme cantonnement : Minot, pour la compagnie d'échelon et le P.C. du bataillon ; Saint‑Broing‑les‑Moines pour les compagnies de combat. Arrivé à 22 heures, le bataillon reprend, dès 3 heures du matin, la route du sud, en vue de gagner Autun en passant par Précy‑sous‑Thil.
Journée du 15 juin.
Parties à 3 heures, les unités arrivent à l'entrée d'Autun vers 10 heures. Le commandant les y a précédées, a pris contact avec le commandant de la place d'Autun et fixé les cantonnements :
P.C. du bataillon et compagnie d'échelon : Grande-Verrière ;
Compagnies de combat : Saint‑Lerger‑sous‑Bois.
Dans la soirée un ordre du général Bourguignon, commandant les chars de l'armée prescrit que les éléments de chars doivent franchir la Loire le plus tôt possible et se regrouper à Souvigny. Cet ordre est aussitôt transmis aux unités ; le mouvement commencera le lendemain dès l'aube.
Journée du 16 juin .
Parti à 4h30, le bataillon arrive à Souvigny vers midi. Mouvement pénible à cause de l'encombrement des routes.
Dans la soirée, le 67e bataillon (commandant Valleteau), le parc d'engins blindé n° 4 (commandant Peyglet) et le parc d'engins blindés n° 2 (commandant Giraud) arrivent également à Souvigny.
Le commandant Giordani prend le commandement de l'ensemble.
Journée du 17 juin.
Dans la matinée du 17, le commandant apprend que les Allemands ont passé la Loire à La Charité‑sur‑Loire et reçoit l'ordre de se replier sur la région d'Auzances (30 kilomètres nord-est d'Aubusson). Départ : 11 heures pour la première rame. Ordre de marche : 7e, 67e, P E.B. n° 4 et P.E.B. n° 2.
Journée du 18 juin.
Dans la nuit du 17 au 18, le commandant Giordani reçoit un officier de liaison du général inspecteur des chars (capitaine Vernies), qui lui prescrit de continuer le mouvement vers le sud-ouest, premier cantonnement à Saint‑Léonard-de‑Noblat (22 kilomètres est de Limoges).
Départ : 5 heures; arrivée à Saint‑Léonard vers 11 heures.
Dans l'après-midi le commandant se rend au camp de La Courtine, à l'état-major du général inspecteur des chars où il reçoit l'ordre de se porter dans la région sud de Confolens et de se mettre à la disposition du colonel Baron, chargé du regroupement des différents éléments de chars.
Journée du 19 juin.
Départ à 5 heures pour la région de la Rochefoucauld, stationnement des unités :
P.C. du 7e bataillon, 2e et 3e compagnies et compagnie d'échelon : Coulgens ;
1ère compagnie : Jauldes ;
67e bataillon : Aurillac ;
P.E.B. n° 4 : Ledeffents ;
P.E.B. n° 2 : Taponnat.
Journée du 20 juin.
Ayant pris contact avec le colonel Baron, le commandant Giordani reçoit l'ordre de gagner Frayssinet-en-Gelat.
Départ : 11 heures pour le premier élément. Arrivée à Frayssinet vers 20 heures.
Itinéraire : Montbron, Rougnac, Ribérac, Mussidan, Bergerac, Montpasier, Villefranche-de‑Périgord ; Frayssinet-en‑Gelat.
Répartition des cantonnements :
7e : Freyssinet ;
67e : Les Fagettes ;
4e P.E.B. : Sabiac ;
2e P.E.B. : Cougoulac.
Journées des 21, 22 et 23 juin.
Repos. Les unités font reposer les hommes, graisser et réparer le matériel. Le 23, le commandant Giordani reçoit l'ordre de porter son groupement dans la région de Fargues, sud de Marmande.
Journée du 24 juin.
Départ à 4 heures.
Mouvement terminé à 11 heures.
Itinéraire : Fumel, Libos, Villeneuve, Sainte‑Livrade, Aiguillon, Anzex, Fargues.
Répartition de ces cantonnements :
7e bataillon : Fargues ;
67e bataillon et P.E.B, n° 2 : Caubeyre ;
P.E.B. n° 4 : Saint Julien.
Le 17e bataillon, rattaché au groupement, rejoint dans l'après-midi son cantonnement à Saint‑Léon.
Dans la soirée le groupement reçoit l'ordre de se porter le plus tôt possible dans la région ouest d'Auch.
Départ à 21h30.
Itinéraire : Nérac, Condom, Auch, Gimont, Nouga, Roulet.
Répartition des cantonnements :
7e bataillon et P.E. B. n° 4 : Puycasquier ;
17e bataillon : Marsan ;
67e bataillon et P.E. B. n° 2 : Tourrenquets, Mirepoix.
Journée du 25 juin.
Installation au cantonnement.
Nouvelle de la signature de l'armistice.
Journée du 26 juin.
Stationnement à Puycasquier. Les P.E B. n° 2 et 4 rejoignent le P.E.B. n° 101 à Lefousseret.
Journée du 27 Juin.
Le groupement va cantonner :
7e bataillon : Montbrun ;
67e bataillon : Saint‑Paul ;
17e bataillon : Caubiac‑Thil.
En outre, le 4e bataillon de chars ayant rejoint le cantonnement de Levignac, le commandement du groupement de chars sera désormais assuré par le chef de bataillon de Saint-Sernin.
Le chef de bataillon Giordani est affecté à l'Ecole des chars, comme directeur de l'instruction militaire, à compter du 1er juillet 1940. Mais l'Ecole est installée tout près, à Fleurance et le commandant Giordani peut, tout en assurant le service de l'École, continuer de s'occuper du bataillon jusqu'à sa dissolution le 31 juillet.
Encadrement du bataillon à l'arrivée à Montbrun.
Chef de bataillon : commandant Giordani.
Officier adjoint et officier de renseignements : lieutenant Delorme.
Officier adjoint technique : lieutenant Riens.
Officier des détails : sous‑lieutenant Tillot
Officier des transmissions : lieutenant Rougier.
Médecin : lieutenant médecin Fleury.
1ère compagnie.
Lieutenant David. Sous‑lieutenant Ayoun. Sous‑lieutenant Pierre.
2e compagnie.
Capitaine Join‑Lambert Lieutenant Fromond Sous-lieutenant Danne
3e compagnie.
Capitaine Mignotte Lieutenant Héraud
Compagnie d'échelon.
Capitaine Valude Lieutenant Erny Lieutenant Wallar Lieutenant Durlrman.
CANTONNEMENT A MONBRUN ET DISSOLUTION DU BATAILLON.
Du 28 juin au 31 juillet, le bataillon cantonne dans les condition suivantes :
Etat‑major et compagnie d'échelon du bataillon : Montbrun ;
1ère compagnie : Garac ;
2e compagnie : Vignaux ;
3e compagnie : Encausse.
Une compagnie de marche est formée dès le début de juillet et mise à la disparition du bataillon Valleteau, en vue de constituer un escadron de cuirassiers. C'est le seul événement marquant de cette période d'un mois où le 7e bataillon reçut de la population civile un accueil particulièrement chaleureux. La tenue disciplinée du bataillon fut appréciée de tous, ainsi qu'a tenu à le témoigner officiellement, M. le comte de Pins, maire de Montbrun.
Dès le 16 juillet toutes mesures furent prises en vue de reverser progressivement les différents matériels au parc d'arrondissement d'Auch.
Le 31 juillet, à 24 heures, consacra la dissolution du 7e bataillon par le colonel commandant l'arrondissement d'Auch, assisté de M. l'intendant du département du Gers.
Ainsi prit fin l'histoire de ce magnifique bataillon dont la caractéristique a été de ramener intact tout le matériel non détruit au combat et d'avoir pu porter présent tout le personnel non disparu aux engagements du 14 mai ou du 10 juin.
CONCLUSION.
Engagé deux fois au cours de la campagne, le 7e bataillon de chars légers s'est couvert de gloire au cours de chacun de ses combats.
Le 14 mai ayant appris au P.C. de la 55e D.I. que le dispositif de la division qui tenait le secteur était rompu et que, pour enrayer coûte que coûte la progression d'une Panzerdivision, il fallait contre-attaquer, à tout prix, le plus tôt possible, le 7e bataillon de chars légers n'a pas hésité à se sacrifier.
Appuyé par le 213e R.I., à effectifs très réduits, médiocrement armé et approvisionné, il s'élance seul sur un front de 5 kilomètres et, ayant progressé sur plus de 2 kilomètres, résiste pendant quatre heures à la ruée des engins ennemis.
Un seul groupe de 75 tirant à vue le soutient. Et cependant, à aucun moment, il ne refuse le sacrifice qui lui est demandé.
Certains équipages (lieutenant Leclair, aspirant Crémieux-Bach) se jetèrent littéralement sur l'ennemi. Battu dans cette lutte inégale, par l'armement plus puissant de l'ennemi, le bataillon ne rompit le combat qu'à bout de forces, et de munitions, ayant perdu dans la bataille 50 % du personnel engagé et 70 % de ses appareils. Le cran des équipages partant au combat, instruits du sacrifice que l'on attendait d'eux, n'a pas faibli un seul instant. Contenant seul quatre heures durant l'assaut des engins ennemis sur un front de division, il a permis à la 3e D.I.M. et à la 3e D.C.r. d'arriver et de s'installer défensivement. C'est une nouvelle page à la gloire de l'armée qu'a écrite de son sang, le 14 mai 1940, le 7e bataillon de chars légers.
Le 10 juin, réduit à une compagnie et encore grâce au tour de force réalisé ‑ pour remettre en état le matériel éclopé ‑ par ses ouvriers, ses dépanneurs et ses équipages, c'est avec la même ardeur, avec la même foi, qu'il se lance à nouveau dans la bataille après une marche d'approche de plus de 12 kilomètres sous un très violent bombardement d'artillerie, qu'il bondit à l'assaut du dispositif ennemi ; en moins de deux heures, malgré le bombardement intensif de 62 avions et de l'artillerie, il reconquiert les objectifs assignés sur une profondeur de 7 kilomètres. La brutale réaction de l'ennemi ne réussit pas un seul instant, à émousser le cran de ses équipages qui font à nouveau l'admiration du fantassin. Par son mordant. il arrête la vague ennemie qui déferle sur Vouziers, et retarde de vingt-quatre heures son avance.
Fidèle à sa devise "Seigneur suis" dont les caractères sont gravés en lettres d'or sur son insigne frappé aux armes de Paris, il a de son sang gagné son titre de Seigneur à la bataille.
Officiers, sous‑officiers, caporaux et chasseurs du 7e bataillon de chars légers, restez fidèles au souvenir de votre magnifique unité. Vous en avez fait un bataillon d'élite. Votre foi en lui perpétuera le vivant exemple de votre force.
Vivent les chars !
Vive le 7e bataillon de chars légers